Fruit du travail collectif d’une vingtaine de scientifiques et d’expert·es, ce recueil publié par Le Lierre vise à éclairer les débats publics et à proposer des pistes d’action concrètes pour accompagner la transition agricole et alimentaire.

À travers une quinzaine de contributions, il aborde les grandes controverses qui traversent aujourd’hui l’agroécologie : viabilité économique, politiques publiques, normes environnementales, place de la science dans le débat public, et bien d’autres.
Introduction

Depuis 2023, la France a été le théâtre de nombreuses manifestations agricoles. Les tracteurs bloquant les autoroutes ou les panneaux de villages retournés pour symboliser un système “qui marche sur la tête” ont illustré de manière forte la détresse d’une partie du monde agricole. Parmi les revendications de manifestants et de certains syndicats, des demandes sur les prix, le fonctionnement des filières, mais aussi des attaques directes des normes agri-environnementales. Celles-ci, accusées d’être trop complexes, ont été présentées comme des freins au bon fonctionnement des exploitations, à leur rentabilité et à la juste concurrence ; la France étant présentée comme un pays plus exigeant que ses voisins européens en particulier.
Ces critiques sont venues s’ajouter à celles déjà présentes en toile de fond sur la transition vers un modèle agroécologique.
La réduction de l’usage des pesticides ou des engrais de synthèse, le développement de l’agriculture biologique ou d’un élevage à l’herbe seraient irréalistes, impossibles, trop complexes et coûteux à mettre en place …
Leur développement induirait des pertes de rendements qui menaceraient notre souveraineté alimentaire et la capacité de l’agriculture française à “nourrir le monde”. Beaucoup de débats ont eu lieu, dans l’espace public et dans les médias. Derrière des inquiétudes légitimes – assurer notre sécurité alimentaire, garantir un revenu juste aux agriculteurs – de nombreuses contre-vérités sur l’agroécologie ont pu être entendues.
Comme pour beaucoup d’organisations actives sur les enjeux agricoles et environnementaux, cette période a suscité des questionnements pour les membres du Lierre, tous et toutes acteurs publics et actrices publiques, et conscient.e.s de l’importance du sujet.
Comment de telles contre-vérités peuvent-elles continuer à circuler, alors que les études scientifiques démontrent depuis de nombreuses années d’une part la nécessité et la désirabilité d’aller vers des modèles agricoles plus durables, et d’autre part que des solutions techniques et systémiques sont d’ores et déjà disponibles et adaptables à de nombreux systèmes ?
Au sein même de nos administrations, de nos universités, de nos associations, ces résultats scientifiques ne se diffusent pas toujours avec la vitesse et l’ampleur nécessaires.
De plus, la complexité des systèmes agricoles et alimentaires, la diversité des pratiques et des situations, le nécessaire besoin de finesse lors du traitement de certaines problématiques font que même les plus convaincu.e.s manquent parfois d’une vision claire sur la possibilité réelle de mettre en place telle ou telle orientation ou système, d’atteindre tel ou tel objectif.
Nous manquons parfois d’arguments pour participer avec justesse à certains débats qui ont lieu tous les jours sur nos lieux de travail. Nous avons besoin d’outils qui permettent de clarifier, sous un format court, des positionnements scientifiques sur différentes controverses entourant les systèmes agroécologiques, pour se former, autant que pour servir de base de dialogue avec d’autres.
C’est ainsi qu’est né ce projet de recueil, qui cherche à proposer une réponse à cette difficulté, ressentie par les membres du Lierre, pour aider toutes personnes en quête de clarification sur les grandes controverses autour de l’agroécologie.
Objectifs et structures des fiches
La rédaction de ce recueil répond à plusieurs objectifs :
- s’appuyer sur des expertises scientifiques, Au
- clarifier les concepts,
- sortir des idées préconçues voire des caricatures,
- rassembler des pistes pour avancer pragmatiquement vers un système agri-alimentaire au service de tous et toutes.
Ce recueil est structuré de la manière suivante :
- La première fiche par Marion Guillou rappelle les raisons pour lesquelles la science appelle à une agriculture plus durable, et précise le sens du terme “agroécologie”.
Les fiches suivantes interrogent la souhaitabilité de la transition agroécologique.
- Guillaume Martin questionne l’existence d’un risque de baisse de la production mondiale suite au développement de l’agroécologie,
- Benoît Daviron déconstruit l’idée du besoin de produire plus pour “nourrir le monde”,
- Alain Karsenty éclaire les liens entre agroécologie et déforestation
- Harold Levrel explique les liens entre agroécologie et souveraineté alimentaire en France.
Une fois ces éléments posés, le recueil explore la faisabilité concrète du passage à une agriculture mobilisant les principes de l’agroécologie, avec peu d’intrants de synthèse.
- Florence Jacquet décrypte la question de la réduction de l’usage des pesticides,
- Thierry Brunelle celle de la réduction de l’usage des engrais de synthèse.
Puis deux auteurs s’intéressent de plus près au cas spécifique de l’agriculture biologique (AB).
- Laure Mamy et Pierre Benoît présentent les différences de toxicité entre les produits de protection des plantes autorisés en AB et ceux autorisés en agriculture conventionnelle.
- Eve Fouilleux interroge les causes des difficultés de généraliser l’AB au-delà d’une “niche”.
Les fiches suivantes s’intéressent au cas particulier de l’élevage et de ses impacts :
- Michel Duru explore la questions de ses émissions de gaz à effet de serre et Fabrice Beline le besoin d’élevage pour fertiliser les cultures.
Enfin, les dernières fiches s’intéressent au “comment faire ?” à d’autres niveaux que celui des pratiques agricoles.
- Charlie Brocard explore comment agir sur la consommation de viande des ménages
- Lucile Rogissart étudie si les produits issus de l’agroécologie seraient réellement plus chers à la consommation.
- Dorian Guinard revient sur l’idée que la France “sur-transposerait” les normes européennes au détriment de ses agriculteurs,
- Alexis Aulagnier revient sur les politiques de réduction des pesticides, nous interrogeant sur comment nous définissons ce qui constitue ou non une alternative suffisamment viable aux pesticides chimique pour permettre leur interdiction.
- Jean-Noël Jouzel, Giovanni Prete et Sylvain Brunier déconstruisent la “colère des agriculteurs” et sa supposée origine dans les normes environnementales.
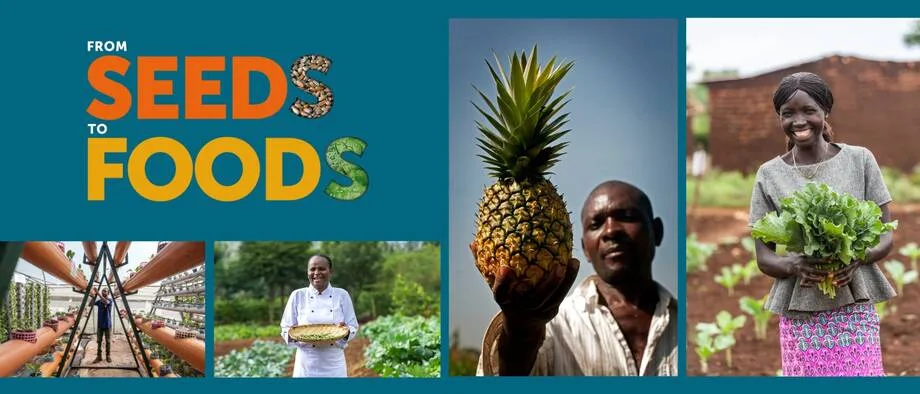
Messages clés
Ce recueil aborde des controverses autour des systèmes agricoles et alimentaires agroécologiques, dont la mauvaise compréhension constitue un frein à l’action. Chaque fiche traite d’un sujet différent avec des approches différentes. Pourtant, de multiples éléments reviennent de manière transversale, constituant autant de messages clés à retenir :
1. Les transitions vers des systèmes agricoles et alimentaires agroécologiques constituent un impératif majeur, incontournable et nécessaire.
Les systèmes conventionnels présentent une menace pour la biodiversité et le climat, ainsi que pour la santé humaine. Le niveau de production des systèmes agroécologiques n’est pas fortement réduit dans toutes les filières par rapport aux systèmes conventionnels, et l’augmentation des connaissances va encore permettre de réduire les écarts de rendement qui existent. Les systèmes agroécologiques sont même les meilleurs garants de la sécurité alimentaire, qui dépend moins de notre capacité à produire plus que de notre capacité à distribuer équitablement les productions et à maintenir des agroécosystèmes fonctionnels. Il en est de même pour la souveraineté alimentaire de la France, qui est négativement impactée par la dégradation de l’environnement tout comme par notre forte utilisation d’intrants.
2. Les transitions agroécologiques sont possibles techniquement.
Du point de vue agronomique et zootechnique, rien n’empêche une réduction des pesticides, des engrais ou de l’élevage intensif sans lien au sol, même si de telles transformations présentent une complexité réelle et demandent des changements de pratiques dont l’importance et la difficulté ne sont pas à nier. L’agriculture biologique constitue déjà, en France et dans le monde, un exemple de réussite.
3. Renforcer la durabilité et l’équité de nos systèmes agricoles et alimentaires nécessite d’agir à tous les niveaux des chaînes de valeur.
Les changements de pratiques au niveau des parcelles agricoles ne pourront avoir lieu sans d’importantes transformations au niveau de l’amont et de l’aval des filières (consommation, agro-industries, distribution, restauration, etc.). Ces transformations nécessitent des politiques publiques dédiées.
4. La réduction planifiée et maîtrisée de la production et de la consommation de produits animaux, ainsi que la revalorisation de systèmes vertueux est une clé de voûte de l’agroécologie.
Il ne s’agit pas d’un appel à un véganisme strict et généralisé mais un appel à une consommation réduite, raisonnée et de qualité, permettant de soutenir des types d’élevage vertueux qui offriraient à nos éleveurs un niveau de vie décent. Réduire les productions animales et leurs importations permettrait de dégager des marges de manœuvre pour les transitions, notamment en termes de réallocation des surfaces cultivées. Tout comme en réduire la consommation viendrait libérer des marges de manœuvre budgétaires pour les ménages.
5. Le développement de l’agroécologie n’implique pas nécessairement un renchérissement du coût de l’alimentation.
L’évolution des régimes alimentaires peut se faire avec des implications différentes pour le budget des ménages selon les mesures mises en place. La précarité d’une part grandissante de la population, et la frustration qu’une autre partie ressent du fait de son incapacité à accéder à l’alimentation recommandée par les pouvoirs publics sont évitables. Un système agroécologique pourra même y apporter des réponses à condition que les politiques adéquates soient mises en place.
6. Questionner la faisabilité économique des transitions agroécologiques est légitime, mais le problème est soluble avec les bonnes politiques publiques.
L’agriculture est un secteur largement subventionné en France et en Europe. Sans nier la difficulté d’enclencher les transitions, il est nécessaire de souligner qu’il existe d’importantes marges de manœuvre pour orienter les systèmes vers l’agroécologie. L’effort de finance publique n’est pas aussi grand que ce qui peut être imaginé, à condition que l’on redistribue différemment les financements actuels alloués aux mondes agricole et alimentaire. La colère d’une partie du monde agricole ne trouve pas ses racines profondes dans des normes environnementales trop ambitieuses, mais notamment dans un système profondément inéquitable qu’il convient de transformer.
7. Ainsi, un système agricole et alimentaire agroécologique ne constitue pas un horizon utopique irréalisable.
Il s’agit bien d’un choix politique, sur les manières d’utiliser l’argent public, de répartir la valeur entre les filières et entre les acteurs au sein de ces filières. Des changements profonds sont à enclencher, qui impliquent des politiques audacieuses. Les hésitations sur le modèle agricole à favoriser, la tentation de promouvoir la co-existence de différents modèles, qui peut être politiquement séduisante pour contourner les conflits, est court-termiste : elle ne peut pas fonctionner.
Conférence de présentation
Pour marquer sa parution, Le Lierre a organisé une conférence à la Fondation Charles Léopold Mayer, animée par Viviane Trèves, pilote du groupe thématique agriculture & alimentation et coordinatrice du recueil.
L’événement a réuni :
– Thierry Brunelle, Directeur adjoint et chercheur en économie au CIRED
– eve fouilleux, Directrice de recherche en science politique au CNRS
– Lucile Rogissart, Chercheuse à I4CE – Institut de l’économie pour le climat / Institute for Climate Economics
– Sylvain Brunier, Chargé de recherche en sociologie au CNRS


