Alors que plus d’un milliard de terriens souffrent de la faim et que l’agriculture européenne traverse une crise sans précédent, vendredi dernier, à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, de nombreux agriculteurs français ont manifesté leur mécontentement et leur inquiétude. Pour France Nature Environnement (FNE), ces deux phénomènes sont liés, la crise laitière étant un révélateur de l’absurdité de la situation mondiale. A cette occasion, FNE livre son analyse et appelle à une remise en cause profonde de la PAC. Jean-Claude Bévillard, chargé des questions agricoles à FNE, explique : « Le lait européen est essentiellement produit par des vaches nourries au soja brésilien. Cette dépendance remet en cause l’agriculture vivrière brésilienne, détruit irréversiblement la forêt primaire, et ne permet pas aux éleveurs européens de vivre de leur activité. L’émergence d’une agriculture de qualité, liée au terroir, permettra de rompre avec cette situation et d’améliorer le revenu de nos éleveurs. »
FNE appelle donc à une rupture dans la politique agricole européenne, avec : – Une régulation environnementale et sociale des échanges internationaux : taxation des produits importés ne répondant pas aux normes environnementales européennes – La réduction de la dépendance de l’élevage européen à l’égard des importations – Une réorientation des aides de la PAC vers une rémunération des prestations environnementales des agriculteurs – Une remise en cause de la politique exportatrice de l’Europe, afin d’œuvrer au développement d’une agriculture nourricière dans les pays en développement plutôt que d’exporter à tout prix ses excédents. FNE demande que la France définisse une position ambitieuse et claire dans les négociations européennes et mondiales qui s’ouvrent sur l’avenir de la PAC après 2013, pour que la politique européenne permette de nourrir sainement les hommes tout en préservant les ressources naturelles. Voici ci-dessous les principaux constats et solutions proposées par France Nature Environnement.LE DEFI ALIMENTAIRE
– Encourager la souveraineté alimentaire en privilégiant l’autonomie de la ferme Europe : Contrairement aux apparences, l’Europe n’assure pas sa souveraineté alimentaire : elle est fortement dépendante de l’extérieur pour l’alimentation protéinique de son bétail. L’utilisation des tourteaux de colza issus de la production d’énergie à la ferme est une des réponses à ce problème, l’augmentation de la part des protéagineux dans les rotations en est une autre. Ainsi, la reconquête de l’autonomie en protéines de la ferme Europe serait bien plus intéressante que le développement des agrocarburants industriels. A plus long terme, il serait nécessaire aussi de réfléchir à une politique permettant d’inciter les consommateurs européens à revoir leur régime alimentaire, notamment en réduisant leur consommation de viande. La PAC doit donc essentiellement viser la souveraineté alimentaire européenne, en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations, notamment en protéines pour l’alimentation du bétail. – Améliorer la régulation environnementale des échanges : La libéralisation totale des échanges agricoles génère des effets négatifs d’ordre social et environnemental. L’Union européenne ne peut accepter des produits importés qui ne répondent pas aux mêmes exigences que celles imposées à ses propres agriculteurs, ou qui sous-tendent des pratiques non respectueuses de l’environnement dans les pays émergents. 80 % des importations européennes de soja contiennent des OGM. Les industries agro-alimentaires et des marchés nationaux et internationaux ont considérablement contribué à la standardisation de la production alimentaire européenne. La diversité et la qualité de nos terroirs est une spécificité européenne à préserver. Les droits de douane et les soutiens internes devraient être fondés sur des critères environnementaux et sociaux. Le produit de ces droits de douanes pourrait être utilisé pour promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de la santé et de l’environnement. L’Union européenne doit par ailleurs préserver son agriculture et ses milieux naturels des pollutions liées aux OGM. L’Union européenne doit également veiller au maintien de la spécificité et de la diversité de ses productions agricoles. – Respecter la souveraineté alimentaire des pays ACP : L’Union européenne doit renoncer aux ambitions exportatrices actuelles de son agriculture car elle n’a pas les surfaces suffisantes pour prétendre nourrir le monde. Les exportations massives dans les pays ACP de produits issus d’une agriculture soutenue financièrement créent en effet une distorsion économique à l’origine de la disparition des agricultures vivrières de ces pays. Le soutien de l’Union européenne à ces pays doit passer par la diminution progressive de ces exportations et le maintien des achats des produits exotiques de qualité durable. La fourniture alimentaire de base ne devrait plus être envisagée qu’à titre ponctuel pour des situations d’urgence (aléas climatiques, sociaux …). Les pays ACP pourraient ainsi se réorienter vers une agriculture vivrière qui leur permettrait d’améliorer considérablement leur souveraineté alimentaire. C’est à cette seule condition que le défi alimentaire mondial pourra être relevé. – Privilégier la qualité sanitaire et environnementale des productions : L’alimentation à prix dérisoires induit des pratiques très nocives pour la santé des producteurs et consommateurs, ainsi que pour l’environnement. Il est donc nécessaire de réorienter le modèle de consommation, en partie construit par la grande distribution. La PAC doit encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la santé, notamment la faible dépendance aux pesticides.LE DEFI ENVIRONNEMENTAL
– Remettre en cause les fondements actuels de la PAC et reconnaître l’environnement comme une condition même de la reproductibilité de l’agriculture : La prise en compte de l’environnement dans la politique agricole doit être reconnue comme fondamentale pour l’avenir même de l’agriculture : c’est le respect des équilibres naturels qui permettra la durabilité de la production agricole en préservant les sols, l’air, la ressource en eau, la biodiversité – fournisseuse d’auxiliaires pour les cultures – et les paysages. Il est donc essentiel que l’environnement figure parmi les objectifs fondamentaux de la PAC, et non pas comme une contrainte ou une concession faite à la société. C’est une condition incontournable de la reproductibilité de l’agriculture, et donc de la durabilité de la souveraineté alimentaire. – Rémunérer les services environnementaux et sociaux rendus par l’agriculture en visant un objectif d’efficience agro-écologique : Compte tenu des besoins alimentaires grandissants et des dégâts écologiques induits par une agriculture productiviste intensive, il ne s’agit plus de promouvoir aujourd’hui la seule productivité brute de l’agriculture mais sa meilleure efficience agro-écologique possible. Il faut donc encourager toutes les pratiques à bas niveau d’intrants (eau, engrais, semences, pesticides, fuel, aliments du bétail…), qui valorisent les milieux avec un coût écologique réduit. La structure de la PAC en deux piliers (l’un étant orienté vers la production et l’autre étant orienté vers les services environnementaux et sociaux rendus par l’agriculture), n’est plus satisfaisante aujourd’hui et ne permet pas une politique agricole commune cohérente. Tout en mettant en place ce pilier unique, il est essentiel de poursuivre un soutien au développement durable des territoires, dans leur diversité. France Nature Environnement demande un soutien aux exploitations agricoles, modulé selon le nombre d’hectares et d’actifs, proportionnel aux services environnementaux rendus aux territoires, évalué selon deux critères indissociables : le degré d’indépendance vis-à-vis des intrants (part des intrants dans le chiffre d’affaires) et la proportion de la SAU de l’exploitation laissée aux infrastructures agroécologiques. Une évolution vers un pilier unique est à envisager. Ce pilier unique serait fondé sur une conditionnalité environnementale renforcée fondée sur une exigence de 5% minimum de la surface agricole de chaque exploitation en surface de régulation écologique. De telles zones, conditionnant l’octroi de paiements de base, constitueraient une garantie de biodiversité, même modeste, dans le terroir agricole, et contribueraient à la mise en oeuvre des réseaux écologiques nationaux (« trame verte ») et paneuropéen. La conditionnalité des aides doit également intégrer de manière significative le bien-être animal. France Nature Environnement demande une extension significative des territoires concernés par la protection de la biodiversité et de la ressource en eau, et un renforcement du réseau Natura 2000. – Réserver les agrocarburants à l’autonomie énergétique de l’agriculture : Parce que l’alimentation humaine doit être prioritaire, parce que les surfaces disponibles sont insuffisantes, et parce que les impacts écologiques, économiques et sanitaires globaux ont été négligés (irrigation de milliers d’hectares de maïséthanol, intensification agrochimique du colza-carburant, augmentation du prix des céréales, suppression des jachères, etc.), les politiques en faveur des agrocarburants doivent être remises en cause. Pour répondre aux enjeux du renchérissement des énergies fossiles et au réchauffement climatique, FNE demande d’encourager la sobriété et l’autonomie énergétiques des exploitations. L’autonomie énergétique de l’agriculture, notamment par l’auto-production d’huile-carburant à la ferme est essentielle pour garantir à long terme la sécurité alimentaire de l’Europe. Mais la valorisation du bois énergie, de l’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, de l’éolien et de la géothermie devrait également être encouragée. FNE demande l’abandon de tout objectif européen en matière de production et d’incorporation d’agrocarburants. L’importation d’agrocarburants doit être interdite si la production est issue de pratiques insoutenables (déforestation de la forêt tropicale, monocultures sur des millions d’hectares de canne à sucre et de palmiers à huile…). – Anticiper le changement climatique : Le changement climatique entraînera des modifications importantes des conditions de la production agricole (bouleversement des saisons, augmentation de la fréquence des sécheresses et inondations, etc.). Afin de préparer ces évolutions majeures, pour certaines imprévisibles, la meilleure réponse possible repose sur la diversification et l’adaptation des cultures aux conditions du milieu. Il est donc indispensable de limiter la spécialisation agricole régionale qui a concentré certaines productions dans quelques régions surproductrices et qui a gravement endommagé les ressources locales (pollution de l’eau et de l’air, érosion des sols, érosion de la biodiversité…). Il est urgent d’instaurer des règles d’utilisation équilibrée de la ressource en eau en respectant la capacité de chaque milieu naturel. La recherche sur les espèces et variétés culturales rustiques déjà existantes, en particulier celles économes en eau, doit être encouragée. L’Europe a besoin d’une politique agricole commune qui réponde au défi alimentaire et écologique européen et mondial.
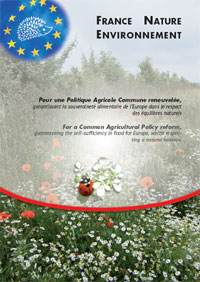


Pour une Politique Agricole Commune renouvelée
Cette réforme de la PAC résoudrait en outre le problème de la pollution de l’air en réduisant considérablement les transports des matières premières et des produits exportés.
Profitant de la baisse de consommation de la viande, je souhaiterais le remplacement progressif de l’élevage intensif (en batterie) par l’élevage extensif (en plein air), ceci pour plusieurs raisons :
– qualité des viandes produites
– bien être animal
– réduction considérable des anti-stress et autres produits administrés aux animaux
– réduction des pollutions de l’eau et production d’algues vertes sur le littoral par épandage de lisiers.