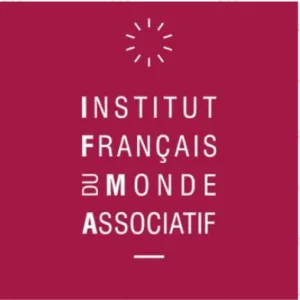Comment les associations contribuent-elles à la transformation socio-écologique des territoires ? Quels savoirs manquent pour mieux reconnaître, qualifier et renforcer cette contribution ? Ce livre blanc de l’Institut français du Monde associatif synthétise les échanges du groupe de travail « Fait associatif, territoires et transition écologique ».
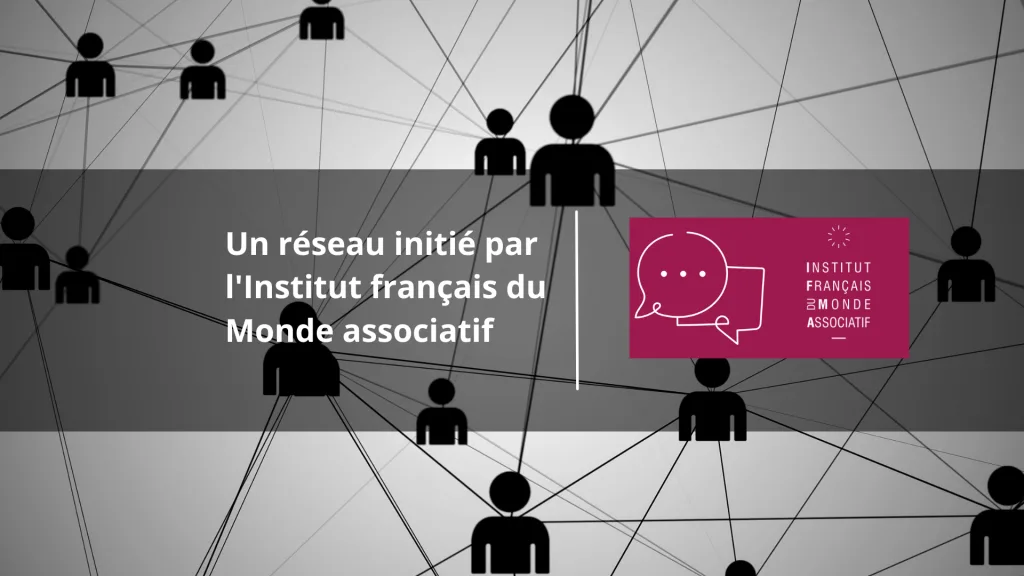
Le document identifie des enjeux de connaissance prioritaires, avec une proposition de deux axes structurants :
- ➡️ la reconnaissance des contributions associatives
- ➡️ le « faire en commun » comme levier de transformation socio-écologique
Des besoins de connaissance prioritaires
Il est question ici de la valeur accordée à la contribution associative à la transition écologique. Comment définir cette valeur ? Il ne s’agit pas d’évaluer financièrement l’apport des associations d’intérêt général, mais comment mesurer leur rôle et leur place dans la production de la transition sociale et écologique ? On parle souvent de valeur sociale, en référence aux travaux de Jean Gadrey, mais il est plus complexe d’attribuer une valeur intégrant aussi la dimension écologique, autrement dit une valeur socio-écologique.
Trois types de tensions ont été identifiés sur ce sujet :
Une tension entre deux approches d’évaluation de la contribution
Elle oppose une logique quantitative, axée sur l’efficacité et la mesure d’impact, à une logique qualitative, qui valorise les contributions systémiques et la création du commun.
Cette opposition reflète également des temporalités différentes : d’un côté, l’urgence d’agir qui pousse à accélérer ; de l’autre, la nécessité de ralentir pour approfondir les transformations.
Une tension entre entreprises et associations
Ces deux univers, souvent opposés, utilisent des outils d’évaluation distincts. Du côté des entreprises, des référentiels comme le Green Deal européen, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et la double matérialité (impact de l’organisation sur l’environnement et réciproquement) encadrent leur
engagement. Mais ces référentiels sont-ils transposables au monde associatif ?
Leur application risque d’être limitée aux très grandes associations, rendant invisibles les nombreuses structures plus petites. Par ailleurs, la RSE ne s’adapte ni au fonctionnement ni aux ressources des associations.
Des travaux de recherche sont en cours pour définir une responsabilité sociétale des associations, mais il manque aujourd’hui des approches adaptées. L’enjeu est donc de produire de la connaissance interdisciplinaire sur ces questions.
Plutôt que d’opposer entreprises et associations, ne faudrait-il pas envisager des transferts d’outils et de méthodes entre ces deux catégories d’acteurs ? Comment
créer des espaces de dialogue, sachant que certaines structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), y compris associatives, se situent à la croisée des deux mondes ?
Une tension entre contribution sociale et contribution environnementale
Peut-on penser ensemble ces deux dimensions de la transition ? Faut-il les évaluer séparément ou au contraire développer des approches intégrées ? Le groupe de travail a souligné l’intérêt d’une approche fondée sur la relation :
- Relation entre humains et non-humains
- Relation des individus à la société et aux territoires
- Relation aux autres et à soi-même
En intégrant cette dimension relationnelle, il devient possible d’articuler plus finement contribution sociale et environnementale, en dépassant les évaluations cloisonnées. Cette approche permet aussi d’élargir l’analyse au niveau territorial, en prenant en compte non seulement l’impact individuel mais aussi les dynamiques collectives et institutionnelles.
Questions clés à approfondir :
- Comment étudier ensemble les contributions environnementales et sociales en particulier au travers de la dimension relationnelle (la relation à soi, puis la relation aux autres, aux autres sur le territoire, la relation à la société et relation au milieu vivant) ?
- Quelles sont les contributions systémiques à la création de commun recherchée par les associations ?
En résumé :
- Comment étudier ensemble les contributions environnementales et sociales, en particulier au travers de la dimension relationnelle (la relation à soi, puis la relation aux autres, aux autres sur le territoire, la relation à la société et relation au milieu vivant) ? Et peut-on dépasser les mesures d’impact sur les individus pris isolément pour aller vers ce que l’on vit en commun, en collectif, avec les institutionnels ?
- Que nous apprendrait l’échelle géographique de la contribution associative associée à la temporalité de la contribution ? Les associations ont-elles la main sur la durée de leur action ? Le besoin de temps long pour agir en confiance avec leurs parties prenantes est-il pris en compte par exemple ?
- Si l’on interroge les instruments de mesure de la contribution associative, peut-on les homogénéiser sans différenciation entre types d’acteurs ? Peut-on mesurer ce qu’a produit l’interaction entre les différents types d’acteurs sur les territoires ? Que serait une responsabilité sociétale non lucrative ? De quelles philosophies sont porteurs les différents types d’instruments de mesure ?
- Comment penser la contribution démocratique tant en interne aux organisations qu’au sein de la société au prisme des questions d’écologie ?
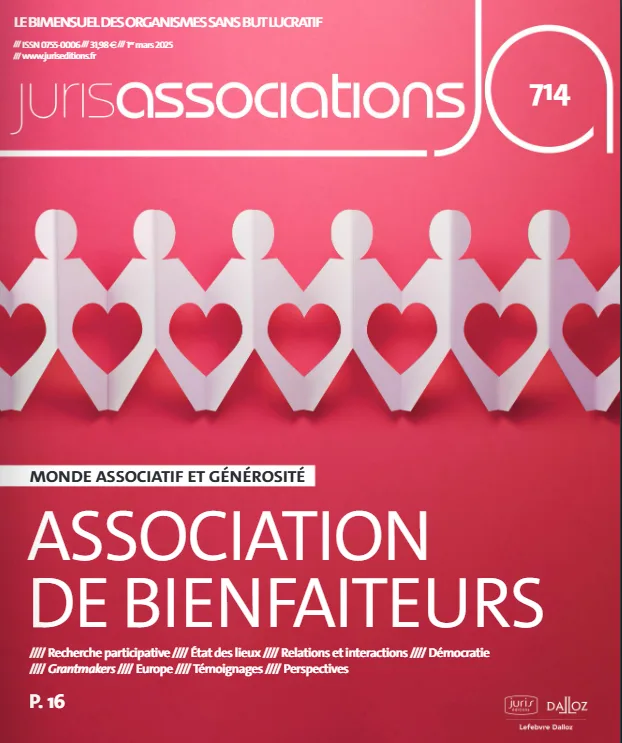
Exemples de questions de recherche :
Au regard de la confusion terminologique entre responsabilité sociétale, RSE, RSO, durabilité, soutenabilité, résilience : qu’est-ce que signifierait une Responsabilité sociétale des associations ?
- Question proposée par Guillaume Plaisance, Maître de conférences en sciences de gestion, IAE Bordeaux
Cette question interroge à travers les normes, les référentiels et modalités de connaissance, la notion même de contribution associative à la transition écologique. Cela concerne particulièrement les associations les plus grandes, déjà amenées à travailler sur les enjeux de transition écologique et qui rendent des comptes sur ce sujet telles que la Croix-Rouge et tant d’autres. Cela concerne également les organismes dits normalisateurs, qui labellisent (IDEAS, le Comité de la Charte…). Aujourd’hui, il y a confusion entre la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et des responsabilités sociétales des organisations (RSO). On voit des associations adopter des rapports RSE alors que cette dernière a été pensée dans la littérature et plus globalement dans le monde professionnel comme étant une forme de compensation du profit créé par les entreprises, alors que ce serait approprié de parler de responsabilité sociétale des associations. On observe un mélange des genres entre responsabilité sociétale de l’organisation, responsabilité sociétale dans son sens le plus large, développement durable, soutenabilité, résilience. Grâce à une revue de littérature, il a été montré en sciences de gestion que tous ces concepts étaient différents. Comment faire face à cette diversité de concepts lorsque on est praticien d’une petite, d’une moyenne ou d’une grande association ? Qu’est-ce que cela voudrait dire, par exemple, d’avoir une stratégie de soutenabilité c’est-à-dire chercher à rester actif et présent pour les bénéficiaires et pour la société le plus longtemps possible et dans des conditions qui n’altèrent pas, en outre, le bien-être des bénévoles, le bien-être des salariés et qui maximisent l’effet positif sur les personnes ciblées ? Est-ce que ce sont des nouvelles pratiques à inventer ? Il semblerait important de se mettre d’accord en France sur ce que ces concepts signifient. Est-ce une pratique inspirée de la RSE, auquel cas on tombe dans des travers problématiques ? Ou bien sont-ce des nouvelles pratiques à inventer ? Faut-il que le monde associatif, lui-même, définisse ce que signifie la responsabilité associative ? Il existe des contributions scientifiques à date sur les entreprises de l’ESS mais pour le monde associatif d’intérêt général, le besoin de connaissance est fort.
Qu’est-ce qui fait le caractère transformatif d’une transition socio-écologique et quelle serait la contribution des associations à cette dynamique transformative ?
- Question proposée par Lydie Laigle, Directrice de recherche au Centre scientifique et technique, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
La transition écologique reste un concept flou. Il y a un écart important entre une transition énergétique épaulée par une ville par exemple ou par des développeurs, et une transition énergétique de collectifs, de centrales villageoises. Ce n’est pas la même transition énergétique écologique. Elle ne transforme pas du tout les mêmes relations au territoire, les mêmes montées en compétences, le partage des initiatives, y compris du processus démocratique, qui n’ont vraiment rien à voir dans ces différentes transitions. Lorsqu’on regarde par exemple les compagnons bâtisseurs dans le quartier d’habitat social de Lannion, ils rapportent qu’ils avaient un contrat avec le bailleur, qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient mais n’avaient pas vraiment de compétences sur les sujets de transition énergétique. Alors que dans un autre exemple, l’association Halage à L’Île-Saint-Denis gère des emplois d’insertion. Elle crée toute une chaîne d’acteurs sur la fertilisation des terres, voire une transformation qui s’étend à l’échelle des multiples réseaux associatifs autour de cette chaîne d’acteurs, de recyclage des terres, de fertilisation, de compost, etc, et ce avec une mobilisation à l’échelle d’un territoire. Par conséquent, caractériser ce que l’on peut qualifier de transformatif ou de transformation socio-écologique dans la transition permettrait aussi de répondre à la question de la contribution des associations.
Quels rôles jouent les lieux animés par les associations dans la transition écologique et sociale des territoires ?
- Question proposée par Léa Billen, Chercheuse et formatrice, Institut Transitions.
Par lieu, entendons ici les lieux animés par des associations sur les territoires, qu’ils soient tiers-lieux ou pas mais des lieux qui accueillent du public sur différentes thématiques et qui en tout cas sortent des lieux en silos (réemploi, réparation, épicerie solidaire etc..) pour permettre une observation plus
transversale. Quel est le rôle de ces lieux dans l’ancrage de la transition écologique par les associations dans les territoires ? Il semble qu’il existe là une sorte de présupposé selon lequel les lieux contribueraient à la transition écologique et sociale des territoires, à son ancrage à l’échelle des quartiers. Dans quelle mesure les lieux contribuent-ils à cela ? N’est-ce pas plutôt les dynamiques de
mobilisation qu’ils permettent qui sont contributrices de transition ? Il est utile d’interroger ce présupposé-là et se demander à quelles conditions les lieux permettent l’ancrage de la transition écologique.
Comment penser et évaluer une contribution systémique articulant la dimension sociale et environnementale des projets de transition écologique ?
- Question proposée par Elena Lasida, Enseignante-chercheuse, Institut Catholique de Paris
C’est une question d’identification et d’évaluation de la contribution associative dans l’articulation
entre dimensions sociale et environnementale. Il s’agit alors plutôt d’aborder la contribution dans sa
dimension systémique plutôt qu’à travers des indicateurs et des démarches d’évaluation très différentes : très techniques pour la dimension environnementale et souvent beaucoup plus qualitatifs pour la dimension sociale, mais sans lien entre les deux. Si l’on reconnaît que l’environnement est composé d’êtres vivants, mais non humains, ce ne sont plus seulement les impacts qu’il faut évaluer, comme si la nature était seulement une ressource mais aussi les relations telles qu’elles s’organisent et qui relient humains et non humains. Comment peut-on penser des dispositifs d’évaluation qui permettent de penser l’interdépendance entre le vivant humain et le vivant non humain et leur contribution conjointe à un processus de transition écologique et sociale ? Concernant les associations comment intégrer dans ce questionnement le fait que cela renvoie à des types d’associations aujourd’hui distinctes (sociales d’un côté et environnementales de l’autre) ?
Comment faire place et donner « la parole » au vivant non humain dans les délibérations collectives qui le concernent ?
- Question proposée par Elena Lasida, Enseignante-chercheuse, Institut Catholique de Paris
Si on reconnaît que l’environnement est composé d’êtres vivants comme les humains, alors la question se pose de savoir comment les êtres non-humains participent à cette transition en tant que sujets de cette transition. Et du fait qu’ils ne s’expriment pas, qu’ils n’utilisent pas le même langage que les humains, de quelle manière les intègre-t-on dans les délibérations et la prise de décision ? A l’image de l’initiative du Parlement de la Loire qui a essayé de faire place à l’expression d’êtres vivant non humains à travers une multiplicité d’acteurs qui vont parler d’eux, mais aussi à travers une manière d’être en lien avec eux qui ne passe pas uniquement par la parole humaine.
Dans quelle mesure les associations françaises peuvent-elles rendre des comptes sur leur contribution à la transition écologique ?
- Question proposée par Guillaume Plaisance, Maître de conférences en sciences de gestion, IAE Bordeaux
D’un point de vue des sciences de gestion, il est intéressant de travailler sur la manière dont les associations peuvent rendre des comptes vis-à-vis de leurs initiatives quant à la transition écologique. Un concept très important existe en sciences politiques, en sociologie, en économie et bien sûr en sciences de gestion, c’est celui d’accountability, soit la manière dont on rend des comptes, la manière dont on fait vivre la démocratie en interne comme en externe. C’est par cette façon de rendre des comptes que l’association endosse une responsabilité vis-à-vis de ses bénéficiaires, de ses membres, de ses financeurs et de la société quant à la transition écologique. Aujourd’hui, toute une série de rapports et de dynamiques relèvent plutôt des entreprises à but lucratif, parfois du service public. Il
manque en revanche une réflexion qui soit propre au monde associatif, qui tienne compte de ses responsabilités sociétales mais aussi de ses spécificités logistiques, financières, humaines, matérielles. Des exigences de plus en plus importantes pèsent aujourd’hui sur le monde associatif quant à des rapports financiers, d’activités, moraux. Il semble que la tendance soit à une régulation des rapports non financiers, y compris pour les associations, on parle parfois d’études d’impact. Ceci est un enjeu fondamental, conceptuel et terminologique surtout pour les praticiens.
Livre Blanc : Fait associatif, territoires et transition écologique
La transition écologique questionne profondément les modes de vie, les politiques publiques et les dynamiques locales. Les associations, par leur ancrage territorial et leurs pratiques collectives, jouent un rôle central mais encore peu documenté dans cette transformation. C’est dans cette perspective qu’un groupe de travail a été lancé par l’Institut réunissant chercheurs et acteurs associatifs autour des liens entre fait associatif, territoires et transition écologique.
Ce travail s’inscrit dans la continuité du programme de recherche « Révéler la contribution des associations aux territoires », actuellement en cours de déploiement.