Pour que les pratiques agricoles évoluent, il faut que les agriculteurs aient intérêt à le faire et soient accompagnés dans ces changements. Certains pays ont ainsi réussi à réduire durablement l’utilisation de pesticides et engrais chimiques. Voici comment.

Raja Chakir, Inrae; Armand Favrot, Inrae; Hajar Guejjoud, Inrae; Thierry Brunelle, Cirad et Tom Saade, Inrae
En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, c’est une petite musique qui monte : celle des agriculteurs assaillis sous les contrôles et les réglementations environnementales qui menacent la viabilité de leurs exploitations. Une petite musique devenue un cri de colère lors de manifestations un peu partout en Europe, en 2024, et qui a permis de faire retirer en France, par exemple, la version renforcée du plan Écophyto.
L’agriculture se retrouve ainsi à jongler entre plusieurs objectifs : nourrir une population mondiale croissante, assurer un revenu décent aux agriculteurs, tout en protégeant la santé humaine et l’environnement pour la génération actuelle mais aussi pour les générations futures.
Un exemple frappant est celui des intrants chimiques, notamment les engrais synthétiques et les pesticides. Ces derniers répondent à des besoins essentiels : nourrir les plantes et protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs. Mais l’utilisation excessive de ces intrants a des effets néfastes sur la biodiversité, sur la qualité des sols, des eaux et de l’air et sur la santé publique.
Par ailleurs, plus les engrais et pesticides chimiques sont utilisés, moins ils se révèlent efficaces sur le long terme, car les sols se dégradent, et les organismes pathogènes développent des résistances, créant ainsi une spirale de dépendance aux intrants chimiques. C’est pourquoi, il devient nécessaire de réduire leur utilisation.
La bonne nouvelle, c’est que de nombreuses alternatives existent pour réduire leur usage sans pour autant compromettre la production agricole. Cependant, ces pratiques sont encore peu utilisées, car les agriculteurs ne sont que très peu encouragés à le faire sur le plan économique et parce que ces alternatives sont parfois plus difficiles à mettre en œuvre que les solutions chimiques. Mais des pays montrent aujourd’hui que, en accompagnant les agriculteurs, des changements rapides de paradigme peuvent avoir lieu.
Décharger les agriculteurs d’un fardeau
De fait, réduire l’utilisation des intrants chimiques ne peut pas reposer uniquement sur les agriculteurs. Bien que leur rôle soit central, leurs choix en matière d’intrants sont souvent contraints par des obligations contractuelles, économiques et réglementaires.
La transition vers une agriculture plus durable ne peut donc reposer seulement sur leurs épaules. C’est en réalité l’ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire, industrie agrochimique, distributeurs, consommateurs et législateurs qui doit être mobilisé. Les politiques publiques ont un rôle clé à jouer pour inciter les fabricants d’intrants agricoles à orienter leur production vers des alternatives moins nocives.
De leur côté, les consommateurs peuvent peser sur les pratiques agricoles en privilégiant des produits moins dépendants aux intrants chimiques, à condition toutefois d’y avoir accès et d’être correctement informés. Seule une approche systémique, répartissant équitablement les responsabilités, permettra d’éviter que le poids de la transition ne repose sur des agriculteurs souvent soumis à de fortes contraintes économiques.
Pour cela, il existe plusieurs types de mesures dont certaines ont déjà été testées sans grand succès, comme l’instauration de taxes ou de subventions. Mais pour être efficaces, elles doivent être mises en œuvre de façon à ce que chaque acteur ait la possibilité de modifier ses habitudes et ses pratiques et puisse contribuer à une agriculture durable. Allier incitations économiques, pédagogie, et, lorsque la santé humaine ou environnementale est en jeu, interdictions, constitue une approche prometteuse pour encourager chacun à réfléchir à ses choix et à repenser son rapport aux intrants chimiques.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».
Les initiatives danoises ou suisses
L’implication des différents acteurs a eu un impact significatif dans plusieurs pays, notamment européens, qui ont réussi à concilier sécurité alimentaire et réduction de la pollution agricole.
Par exemple, le Danemark, souvent cité comme modèle de réussite, a réduit de 50 % en trente ans (1980-2012) ses excédents d’azote chimiques et organiques néfastes pour les sols et la biodiversité et imputables à la surutilisation d’engrais. Pour cela, le pays a associé des mesures allant de l’action volontaire à une réglementation stricte en impliquant à la fois les agriculteurs et les producteurs d’intrants agricoles.
Un point clé a été de combiner les mesures de façon à rendre la nouvelle réglementation attractive économiquement et à en limiter le coût financier pour les acteurs concernés. Ainsi, la mise en place d’une réglementation interdisant les fortes concentrations de bétail, combinée à la promotion d’une alimentation animale améliorée et à l’instauration de quotas sur les taux de fertilisation, s’est révélée particulièrement efficace pour réduire les excédents d’azote.
Une solution serait ainsi d’inciter le secteur de production d’intrants chimiques, qui a la particularité d’être très concentré et donc plus facile à réglementer à offrir des solutions techniques meilleur marché aux agriculteurs.
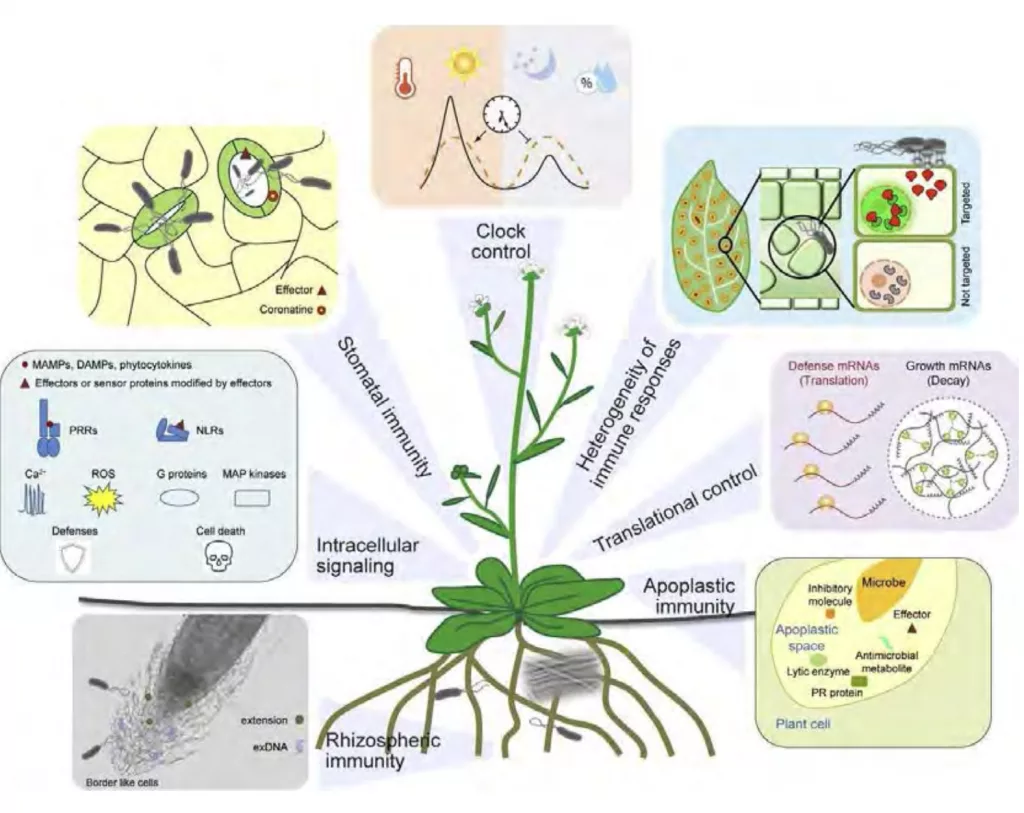
(Source : Zhang et al., 2020)
De son côté, la Suisse a lancé un label « sans pesticides » pour le pain, avec 50 % de la production de blé désormais certifiée avec ce label, soutenue par des paiements directs et des primes garantis par l’État, encourageant ainsi les agriculteurs à réduire leur utilisation de produits chimiques.
Ici, l’engagement des consommateurs par un système de label et des prix compétitifs a été la clé. Bien que la production domestique ne représente qu’environ un quart de la consommation de blé en 2022, cette approche intermédiaire entre agriculture conventionnelle et biologique montre qu’il est possible de concilier faisabilité pour les agriculteurs et objectifs de durabilité environnementale. Ces labels constituent ainsi une autre solution intéressante pour offrir des débouchés aux produits à bas intrants, car les études montrent que les consommateurs ont une préférence pour ce genre de produits.
Cependant, pour que la réussite des politiques de réduction d’intrants chimiques soit complète, il est important de ne pas réfléchir qu’à une échelle nationale, sans quoi nous n’obtiendrons que des déplacements d’usages d’intrants chimiques entre pays, plutôt qu’une réduction nette à l’échelle mondiale.
Les accords commerciaux internationaux, tels que l’accord de libre-échange actuellement discuté avec les pays du Mercosur, doivent constituer des vecteurs pour garantir que les efforts réalisés par un pays ne soient réduits à néant par un surcroît de production dans d’autres pays où les mêmes réglementations ne s’appliqueraient pas.
À un niveau plus global, l’Union européenne, à travers sa stratégie « De la ferme à la fourchette » et sa politique agricole commune (PAC), vise à réduire l’usage des pesticides de 50 % et des engrais de 20 % d’ici 2030, tout en soutenant financièrement des pratiques, comme l’agriculture de précision et l’utilisation d’engrais organiques. Cette stratégie cherche également à promouvoir des chaînes d’approvisionnement alimentaires durables et à renforcer la résilience du secteur agricole face aux défis climatiques.
D’autres initiatives comme le plan Écophyto en France et l’agriculture naturelle en Andhra Pradesh (Inde) illustrent des stratégies concrètes qui démontrent que durabilité et productivité peuvent coexister grâce à des alternatives écologiques, des incitations adaptées, et un accompagnement technique pour les agriculteurs. Cependant, ces initiatives n’ont pas pu aboutir entièrement, rencontrant des obstacles qui ont freiné leur pleine réalisation.
Enfin, il est aussi essentiel de penser aux pays en développement dans ces efforts. En adaptant les solutions à leurs besoins spécifiques, nous pourrons soutenir des pratiques agricoles durables tout en tenant compte des réalités économiques. Une coopération internationale sera ainsi nécessaire pour partager des idées et mettre en place des solutions efficaces à l’échelle mondiale.
La première version de cet article a été rédigée dans le cadre d’un atelier The Conversation, animé par Thibault Lieurade et organisé dans le cadre des Young Researcher Days du projet Cland. Nous remercions chaleureusement Nicolas Guilpart et David Makowski pour leur relecture attentive et leurs commentaires constructifs. Nos remerciements vont également à Raia Massad, qui a coanimé l’atelier, pour son accompagnement précieux.
Raja Chakir, Directrice de recherche en Économie de l’Environnement, Inrae; Armand Favrot, Doctorant en mathématiques appliquées, Inrae; Hajar Guejjoud, Postdoctoral researcher, Inrae; Thierry Brunelle, Chercheur en Économie, Cirad et Tom Saade, Doctorant en biogéochimie, Inrae
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Prospective : Agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050
Réduire drastiquement nos usages de pesticides, diminuer nos émissions de gaz carbonique, en particulier d’origine agricole, satisfaire la demande alimentaire, atteindre une souveraineté alimentaire, préserver la santé humaine, protéger notre environnement… autant d’impératifs concourant à notre bien-être commun et qui ne sont pas simples à atteindre ! Sont-ils seulement compatibles ? L’exercice de prospective « Agriculture européenne sans pesticides en 2050 », réalisé par INRAE, aide à mieux cerner les leviers mobilisables et les trajectoires possibles pour supprimer les pesticides chimiques. Nous vous proposons d’en décortiquer quelques éléments pas à pas…
Explorer des pistes disruptives de solutions en visant un objectif extrême : le zéro pesticide
- Lire l’article et télécharger le rapport complet sur :
https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-europeenne-pesticides-2050
L’État indien du Sikkim est-il vraiment « devenu » 100 % bio ?
Cet État du nord de l’Inde communique de plus en plus sur le fait d’avoir une agriculture entièrement sans pesticide. En réalité, il a surtout été exclu de la « révolution verte » des années 1960 et dépend aujourd’hui des États voisins pour nourrir sa population.


