Pourquoi l’espèce humaine est-elle la seule qui détruit son environnement alors que celui-ci lui permet de survivre ? La réponse à cette question par Anne Coudrain, Directrice de recherche honoraire, en Sciences de l’eau et Anthropocène, à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Pourquoi l’espèce humaine est-elle la seule qui détruit son environnement alors que celui-ci lui permet de survivre ?
Anne Coudrain, Institut de recherche pour le développement (IRD)Tout individu vivant et même toute chose minérale a un impact sur son environnement. Et chacun a des interactions de proche en proche avec les autres.
Les végétaux et les animaux peu à peu évoluent en fonction de ce qui existe dans son environnement. Mais ils ne détruisent pas a priori leur environnement.
Depuis quelques décennies des espèces dites envahissantes sont remarquées : elles prolifèrent en prenant la place d’autres espèces. Par exemple, les perruches au détriment d’autres oiseaux en Europe. Elles ont été introduites par des humains dans des environnements où elles n’étaient pas avant. Au niveau local, elles peuvent faire des « dégâts » sur la faune, la flore ou les cultures mais pas à l’échelon de la planète et sans mettre en question leur propre condition de survie.
Depuis 1950 environ, les indicateurs d’activité humaine (consommation d’eau ou d’énergie, par exemple) et de transformation de la Terre (concentrations en gaz à effet de serre ou température de surface) ont augmenté de façon spectaculaire. Cette montée en régime, nommée la Grande Accélération, amène à une dévastation des enveloppes de la Terre (atmosphère, océans, terres émergées) qui constituent l’environnement des humains, des animaux et des végétaux. Le climat est modifié, les sols sont artificialisés et de nombreux animaux disparaissent. La pollution se généralise dans tous les milieux.
Renverser la tendance de cette destruction est une urgence absolue. Comprendre le pourquoi de cette dégradation aveugle de l’environnement des humains permet d’une part de discerner en quoi il s’agit d’une spécificité des humains et d’autre part d’élaborer de nouveaux imaginaires sur le futur qui inspirent l’espoir.
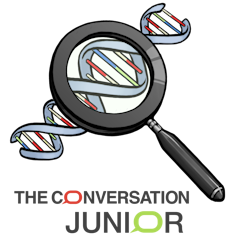
Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre. En attendant, tu peux lire tous les articles « The Conversation Junior ».
Quand les humains se placent hors de la nature
L’anthropologie de la nature est une science qui nous éclaire car elle s’intéresse en même temps aux humains, et à ce qu’ils surmontent de naturel en eux, et à la nature qui se caractérise dans la pensée européenne moderne par l’absence d’humains. Ce champ de recherche initié par Philippe Descola avance que la destruction de l’environnement est liée à la façon de percevoir les lignes de partage entre humains et non-humains.
Depuis l’époque moderne, commencée au XVIe siècle, les Européens ont placé mentalement les plantes, les animaux et les milieux de vie dans la sphère « nature » caractérisée par l’absence des humains. D’un côté il y a les humains, de l’autre il y a la « nature ». Les non-humains (animaux, végétaux, sols, climat…) sont ainsi exclus a priori de notre destinée. Cette façon de penser s’appelle le « naturalisme » et est exceptionnelle : dans les autres continents ou en Europe avant l’époque moderne, les non-humains sont mêlés au tissu des relations sociales avec les humains. Par exemple, les Achuars (nation indigène d’Équateur) fredonnent des poèmes qu’ils adressent aux plantes et aux animaux en étant persuadés que ces derniers les comprennent.
La deuxième étape importante est qu’à partir du XVIIe siècle en Europe, on a commencé à séparer le droit des humains et celui des non-humains. Dans ce sillage, les humains naturalistes, alors européens, deviennent convaincus qu’il est possible d’avoir une croissance infinie de leurs richesses grâce à la « mise en valeur » de la Terre au moyen du progrès infini des techniques (par exemple, des terres qui étaient gérées de façon communautaire deviennent des terrains privés pour le commerce de la laine).
Les grands penseurs du XIXe siècle, par exemple Marx, à l’époque du déploiement de l’industrie n’ont pas perçu que lier l’émancipation de l’humanité à l’augmentation du bien-être impliquait de soumettre la Terre à une exploitation dévastatrice de ses ressources. À cette époque, comme tous les Occidentaux modernes, ils considéraient que la « nature » était indestructible.
Tous les humains n’ont pas le même impact
Au XXe siècle, le « naturalisme » s’étend sur tous les continents. L’utilitarisme devient le mode de relation qui structure les institutions et la façon collective de se rapporter aux non-humains. Cependant seule une portion d’humains cause les effets dénoncés. D’après une étude de 2015 d’Oxfam, seuls 10 % des plus riches émettaient 50 % de gaz à effet de serre alors que les 50 % plus pauvres n’émettaient que 10 %. Ou encore, la consommation de viande qui a de nombreux impacts sur le climat et la biodiversité n’est que 2 kg par an en moyenne par habitant en Inde alors qu’elle atteint 100 kg aux États-Unis.
Au XXIe siècle, de plus en plus de voix s’élèvent pour exprimer le lien de la destinée de l’espèce humaine avec celle de tous les autres non-humains dont il faut prendre soin. Les peuples autochtones, entre autres ceux d’Amazonie, sont de plus en plus reconnus comme sources de savoirs et d’inspirations par les organisations internationnales telles l’IPCC ou WWF. Associés à leur territoire, ces peuples perçoivent intimement l’intrication de la destinée des humains et des non-humains. Ils permettent d’imaginer le foisonnement de possibilités pour rafistoler les liens entre humains et non-humains.
En conclusion, la destruction de l’environnement des humains n’est pas liée intrinsèquement à l’ensemble de l’espèce humaine mais à une succession singulière de phénomènes initiés il y a quelques siècles chez les humains d’Europe avec le « naturalisme » qui a permis le déploiement mondial et aveugle du capitalisme et de l’exploitation de la Terre. Je n’imagine pas des animaux – autres que les humains – capables d’engager une telle succession.

Anne Coudrain, Directrice de recherche honoraire, Sciences de l’eau et Anthropocène, Institut de recherche pour le développement (IRD)


