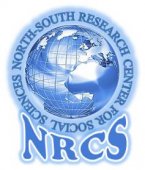Cet article a été publié dans le premier numéro de la Revue de Droit et de Sciences Sociales (juin 2008) éditée par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir (Maroc) en collaboration avec le Centre Nord-Sud de Recherches en Sciences Sociales-NRCS, dirigé par l’auteur. Ce travail, en tant que résultat des recherches effectuées par le NRCS, s’inscrit globalement dans le processus engagé par l’OMT visant à promouvoir un développement durable dans des pays où le tourisme peut en être un vecteur essentiel. Il se situe également dans le cadre du Plan Bleu de l’UNEP qui développe une prospective de coopération entre les 27 pays riverains de la Méditerranée. Plus spécifiquement, cette contribution s’inscrit dans le cadre de la Stratégie du développement touristique adoptée par le Gouvernement marocain suite aux Premières Assises du Tourisme à Marrakech en 2001, et essaie d’enrichir le débat prospectif sur le futur de ce secteur dans le cadre du ‘‘Tourisme 2030’’ initié par le Haut Commissariat au Plan en 2007.
Résumé
De nombreux pays en développement s’organisent actuellement pour développer leur secteur touristique, considéré comme un choix stratégique. Toutefois, la logique du développement associée au tourisme peut s’avérer parfois paradoxale vu que des sociétés peuvent être soit enrichies ou au contraire, déséquilibrées, voire bouleversées par la croissance irréfléchie des flux touristiques. Le tourisme, en sus de ses retombées positives, engendre des impacts socioculturels et écologiques indésirables et représente parfois un certain nombre de risques économiques. Ces constats nous amènent à poser la question de la place du tourisme dans une optique de durabilité en vue d’attirer l’attention sur la nécessité d’un rééquilibrage en faveur d’une activité encore largement sous-estimée, malgré l’importance des flux économiques et des autres impacts qu’elle engendre. Cette contribution s’inscrit dans cet esprit et propose une lecture dans ce qu’il est convenu d’appeler « tourisme durable ». L’ambition est de tenter d’articuler tourisme et durabilité, en fixant les conditions sous lesquelles le tourisme peut être un vecteur de développement, en harmonie avec l’environnement et les intérêts socioculturels et économiques des pays d’accueil (notamment les pays du Sud), et ce dans une logique de dynamique durable. Mots clés: Tourisme durable- durabilité- Indicateurs- Développement- Impacts sociaux-Impacts environnementaux.Liens utiles
Texte complet de l’article Appel à contributions, Revue de Droit et de Sciences SocialesIntroduction
En dépit de la prolifération des facteurs de l’insécurité internationale (terrorisme, résurgence des mouvements racistes et xénophobes, catastrophes naturelles, épidémies, etc.), plusieurs milieux politiques et économiques, intellectuels et civiles ne cessent de défendre l’importance stratégique du tourisme en tant que levier de développement, de rapprochement et de paix entre les peuples, et surtout en tant que vecteur de dialogue interculturel et interreligieux (OMT, 2008). En effet, le tourisme est considéré à la fois comme reflet et facteur de mondialisation et un agent particulièrement efficace de l’intégration d’espaces et de sociétés à la vie internationale. Selon la CNUCED, ce secteur s’impose comme un secteur à haut potentiel, un véritable gisement de richesses et l’une des seules possibilités viables de diversification économique, surtout pour les pays en de développement[[Le tourisme est la première industrie de la planète. Sa progression est de 4 % par an. Si les tendances actuelles se poursuivent, l’OMT prévoit 1 milliard de touriste en 2010 et 1.6 milliard en 2020.]]. Cependant, la place officielle de ce secteur, et de ses enjeux, peut apparaître modeste voire inadéquate et insuffisante. Il est relativement sous-estimé par rapport à d’autres secteurs économiques en dépit du fait qu’il est à présent l’activité la plus dynamique au monde, une source importante de devises[[Par ex. le tourisme a été considéré en 2008, et pour la première fois au Maroc, comme la principale source de devises.]] et de recettes d’exportations devant plusieurs industries développées. Il est aussi le secteur économique qui jouit d’un taux de croissance très rapide et qui implique plusieurs intervenants et activités tant en amont qu’en aval. De part sa nature transversale et son effet d’entraînement sur d’autres secteurs, il est considéré également comme un moyen efficace de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. En se basant sur ces faits, de nombreux PED, y compris le Maroc, s’organisent actuellement pour développer leurs secteurs touristiques et se situer sur le marché du tourisme international. Toutefois, la logique du développement associée au tourisme peut s’avérer parfois paradoxale. Des sociétés peuvent être soit enrichies par l’apport substantiel du tourisme ou au contraire, déséquilibrées, voire bouleversées par la croissance irréfléchie des flux touristiques. Le tourisme, en sus de ses retombées positives, a aussi malheureusement des impacts indéniables sur l’environnement, le patrimoine et les populations des pays d’accueil[[Par ex. la Méditerranée reçoit sur ses côtes en moyenne 2300 touristes/km, sachant qu’elle comporte 46000 km de côtes et que 30 % sont déjà artificialisés. Le Plan Bleu, organisme regroupant tous les pays de la Méditerranée pour étudier la richesse de son patrimoine naturel et culturel, prévoit qu’en 2025, si rien n’est fait pour renverser la tendance, la Méditerranée devra accueillir 3300 touristes/km et que 5000 km supplémentaires seront construits. Par ailleurs, selon l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), le réchauffement des mers dû à l’activité de l’Homme est responsable de la disparition de 20% de la barrière de corail mondiale. Selon la FAO, 38 îles émergeant de 2 mètres à peine au-dessus du niveau de la mer sont menacées de disparition d’ici à 50 ans à cause de la montée des océans due au réchauffement climatique.]]. En plus, cette activité représente également, pour ces pays, un certain nombre de risques : – Elle profite en grande partie aux pays les plus développés et diversifiés vu qu’une grande partie de la manne touristique retourne au Nord[[Ces fuites de revenus sont dues au fait que les touristes achètent fréquemment des voyages « clés en main » dans leur pays, et au fait que beaucoup de fournisseurs de services sont étrangers. Ainsi, les effets directs et multiplicateurs de l’industrie touristique dans de nombreux PED ne sont pas aussi élevés qu’il semblerait, car une grande partie de revenus quitte le pays hôte par ces fuites. Il est difficile de réduire celles-ci car les taux d’imposition y sont bas, et parce que peu de fournisseurs de services locaux ont suffisamment de capitaux à investir dans les infrastructures nécessaires pour attirer et retenir les touristes, sachant qu’ils sont souvent concurrencés par les opérateurs internationaux.]] (les PED ne maîtrisent pas les flux touristiques, qui sont largement contrôlés par des groupes internationaux basés dans les pays industrialisés); – Les comptes en devises sont défavorables car les rentrées sont grevées par des besoins accrus en produits d’importations; – La mono-activité et les mono-structures touristiques sont fragiles, voire dangereuses, car elles sont soumises à une demande conjoncturelle, sujette à d’énormes fluctuations; – Les emplois touristiques sont souvent mal rémunérés, saisonniers et sans possibilités de réelles qualifications; – Le tourisme fragilise le tissu social et bouscule les bases culturelles en renforçant les disparités sociales et en introduisant des modes de consommation souvent non durables; – Enfin, le tourisme, par les transports émetteurs des gaz à effet de serre, contribue au déséquilibre climatique planétaire, et, par ses impacts terrestres, pollue, détruit, surexploite et artificialise les paysages (Raison d’un tourisme différent, 2008). Cependant, jusqu’à présent, les décideurs et le grand public dans plusieurs pays ne sont que peu sensibilisés d’une part aux méfaits du tourisme et d’autre part aux moyens d’y remédier (El Alaoui, 1999). Par ailleurs, le phénomène touristique est actuellement beaucoup plus synonyme de rentabilité économique et financière. Une vision mercantile, indispensable certes pour la viabilité des projets touristiques, mais reste issue d’une vision à court terme, peu cohérente avec les discours sur la « durabilité » (EL Bayed, 2003). Par conséquent, remédier aux dégâts les plus spectaculaires et aux injustices les plus flagrantes que le tourisme peut faire subir aux pays d’accueil, s’avère actuellement un enjeu stratégique plus que jamais. Dans ce sens, et compte tenu de ses différents impacts, on commence à soutenir que le tourisme, s’il pourrait être assimilé à un qualificatif, en l’occurrence à celui de durable ou de responsable, il pourra être un levier essentiel, en offrant, notamment aux PED, de nouvelles possibilités de développement[[C’est dans ce sens que le tourisme a été retenu par la Commission Mondiale du Développement Durable comme thème de l’année 1999.]] Cependant, force est de constater que la recherche dans ce domaine, dans ces pays et au Maroc également, ne s’intéresse guère, ou du moins tardivement, aux questions liées au « tourisme et durabilité ». Les études réalisées sur le tourisme ont jusqu’ici privilégiées une approche sectorielle (soit géographique, aménagiste ou économique), alors que pour mieux cerner un phénomène avec une telle complexité, il est nécessaire d’essayer de le comprendre dans sa globalité. C’est pourquoi une approche sociologique, couplée à une démarche interdisciplinaire, s’impose pour étudier les retombées les plus profondes que pourrait susciter un tel développement touristique. Au fond, cette contribution ne vise pas seulement à vanter les vertus du tourisme, mais à proposer un exercice de réflexion et de méthode, en suggérant d’inscrire le développement touristique dans la durée et de veiller à l’accompagner de mesures préservant les patrimoines et rationalisant l’exploitation des ressources naturelles. En d’autres termes, l’ambition est de tenter d’articuler tourisme et durabilité, en fixant les conditions sous lesquelles le tourisme peut être un vecteur de développement, en harmonie avec l’environnement et les intérêts socioculturels et économiques des populations locales, et ce dans une logique de dynamique durable[[Ce travail s’inscrit globalement dans le processus engagé par l’OMT visant à promouvoir un développement durable dans des pays où le tourisme peut en être un vecteur essentiel. Il se situe également dans le cadre du Plan Bleu de l’UNEP qui développe une prospective de coopération entre les 27 pays riverains de la Méditerranée. Plus spécifiquement, cette contribution s’inscrit dans le cadre de la Stratégie du développement touristique adoptée par le Gouvernement marocain suite aux Premières Assises du Tourisme à Marrakech en 2001, et essaie d’enrichir le débat prospectif sur le futur de ce secteur dans le cadre du ‘‘Tourisme 2030’’ initié par le Haut Commissariat au Plan en 2007.]]. Pour ce faire, et après avoir fait un tour d’horizon des différents impacts sociaux et environnementaux du tourisme, tel qu’il est pratiqué actuellement (I), nous présentons les fondements et les formes du tourisme durable (II); Ensuite nous analysons l’importance et les enjeux des indicateurs de durabilité touristique comme outil de planification et de politique à la portée des décideurs (III); Enfin, nous explorons l’apport du tourisme durable au développement des pays du Sud (considérés largement comme des pays récepteurs ou d’accueil), ainsi que les différents enjeux à relever une fois ce scénario est adopté (IV).