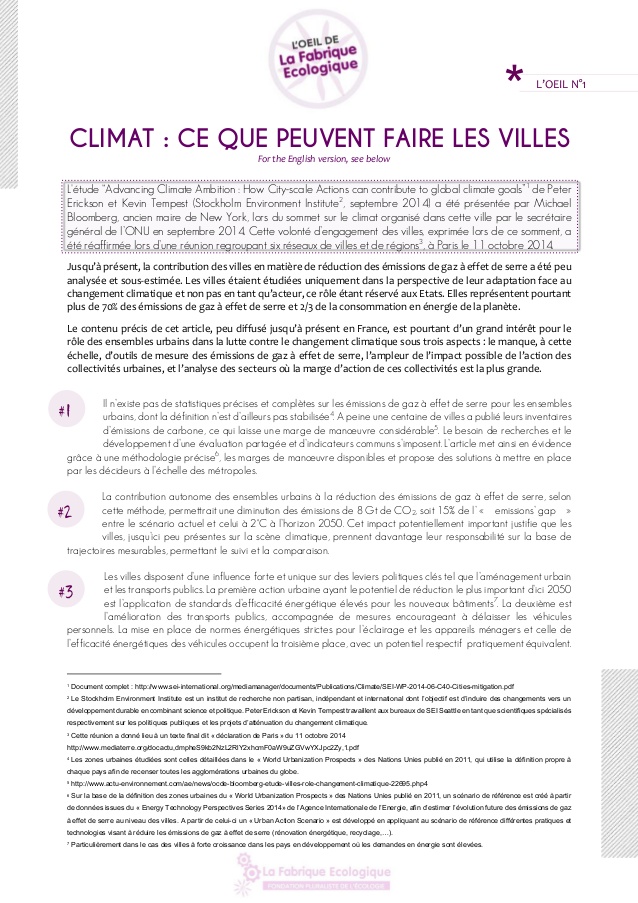« L’oeil de La Fabrique Ecologique » est une nouvelle rubrique permettant de présenter à intervalle régulier des documents jugés pertinents et originaux au travers d’une fiche courte et concise soulignant les idées les plus novatrices. L’oeil N° 1 s’intéresse à ce que peuvent faire les villes dans l’atténuation ou l’adaptation au dérèglement climatique. L’étude “Advancing Climate Ambition : How City-scale Actions can contribute to global climate goals” de Peter Erickson et Kevin Tempest (Stockholm Environment Institute, septembre 2014) a été présenté par Michael Bloomberg, ancien maire de New York, lors du sommet sur le climat organisé dans cette ville par le secrétaire général de l’ONU en septembre 2014. Cette volonté d’engagement des villes, exprimée lors de ce somment, a été réaffirmée lors d’une réunion regroupant six réseaux de villes et de régions, à Paris le 11 octobre 2014.
Jusqu’à présent, la contribution des villes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre a été peu analysée et sous-estimée. Les villes étaient étudiées uniquement dans la perspective de leur adaptation face au changement climatique et non pas en tant qu’acteur, ce rôle étant réservé aux Etats. Elles représentent pourtant plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre et 2/3 de la consommation en énergie de la planète. Le contenu précis de cet article, peu diffusé jusqu’à présent en France, est pourtant d’un grand intérêt pour le rôle des ensembles urbains dans la lutte contre le changement climatique sous trois aspects : le manque, à cette échelle, d’outils de mesure des émissions de gaz à effet de serre, l’ampleur de l’impact possible de l’action des collectivités urbaines, et l’analyse des secteurs où la marge d’action de ces collectivités est la plus grande. – 1 Il n’existe pas de statistiques précises et complètes sur les émissions de gaz à effet de serre pour les ensembles urbains, dont la définition n’est d’ailleurs pas stabilisée[[Les zones urbaines étudiées sont celles détaillées dans le « World Urbanization Prospects » des Nations Unies publié en 2011, qui utilise la définition propre à chaque pays afin de recenser toutes les agglomérations urbaines du globe.]]. A peine une centaine de villes a publié leurs inventaires d’émissions de carbone, ce qui laisse une marge de manoeuvre considérable[[- OCDE : les Etats doivent aider leurs villes à lutter contre le changement climatique]]. Le besoin de recherches et le développement d’une évaluation partagée et d’indicateurs communs s’imposent. L’article met ainsi en évidence grâce à une méthodologie précise[[Sur la base de la définition des zones urbaines du « World Urbanization Prospects » des Nations Unies publié en 2011, un scénario de référence est créé à partir de données issues du « Energy Technology Perspectives Series 2014 » de l’Agence Internationale de l’Energie, afin d’estimer l’évolution future des émissions de gaz à effet de serre au niveau des villes. A partir de celui-ci un « Urban Action Scenario » est développé en appliquant au scénario de référence différentes pratiques et technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (rénovation énergétique, recyclage,…).]], les marges de manoeuvre disponibles et propose des solutions à mettre en place par les décideurs à l’échelle des métropoles. – 2 La contribution autonome des ensembles urbains à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon cette méthode, permettrait une diminution des émissions de 8 Gt de CO2, soit 15% de l’ « emissions’ gap » entre le scénario actuel et celui à 2°C à l’horizon 2050. Cet impact potentiellement important justifie que les villes, jusqu’ici peu présentes sur la scène climatique, prennent davantage leur responsabilité sur la base de trajectoires mesurables, permettant le suivi et la comparaison. – 3 Les villes disposent d’une influence forte et unique sur des leviers politiques clés tel que l’aménagement urbain et les transports publics. La première action urbaine ayant le potentiel de réduction le plus important d’ici 2050 est l’application de standards d’efficacité énergétique élevés pour les nouveaux bâtiments [[Particulièrement dans le cas des villes à forte croissance dans les pays en développement où les demandes en énergie sont élevées.]]. La deuxième est l’amélioration des transports publics, accompagnée de mesures encourageant à délaisser les véhicules personnels. La mise en place de normes énergétiques strictes pour l’éclairage et les appareils ménagers et celle de l’efficacité énergétiques des véhicules occupent la troisième place, avec un potentiel respectif pratiquement équivalent.Déclaration de Paris 11/10/14
Fiche Climat : ce que peuvent faire les villes
L’oeil N°1 de La Fabrique Ecologique – Télécharger « Climat : ce que peuvent faire les villes » au format .pdf