On parle depuis plus de 20 ans d’urgence climatique ! Cette expression remonte à 1997 dans la presse française, nous rappelle Iris Viloux (Université Paris-Panthéon-Assas). Et paradoxalement, malgré sa démocratisation, l’injonction à agir qu’elle contient n’est pas (encore) advenue … L’action avance lentement, à l’inverse des mots urtilisés et malgré l’enfer des chiffres. Car l’urgence d’agir est supposée se traduire dans les objectifs chiffrés des politiques climatiques. Mais est-ce vraiment le cas ? Marc Delepouve (CNAM) a étudié la façon dont le monde politique reprend les travaux du GIEC. Pour lui, ils conduisent à une sous-estimation des risques du fait de la simplification du savoir scientifique réduit à quelques chiffres.
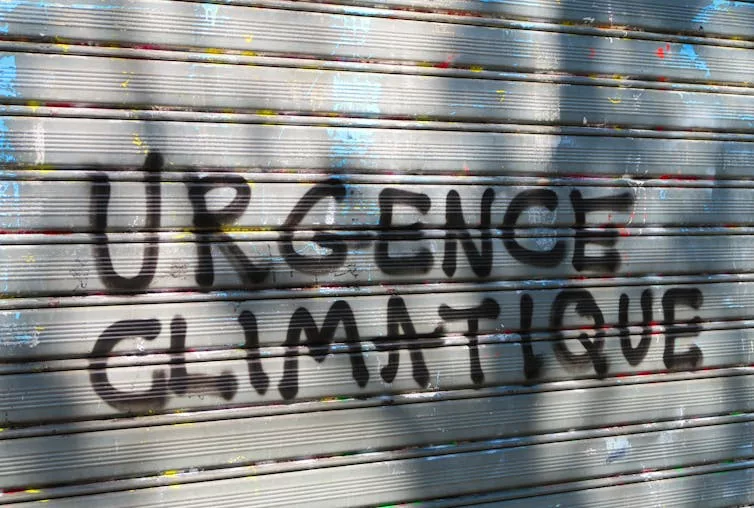
Iris Viloux, Université Paris-Panthéon-Assas
Dans un de ses derniers reportages, Enquête exclusive, une des émissions les plus populaires de la télévision française, proposait aux téléspectateurs le sujet suivant : « Urgence climatique : quand la jeunesse se radicalise ». L’émission promettait de présenter les modes de mobilisation des militants écologistes contemporains :
« Ils bloquent des autoroutes, aspergent de soupe des œuvres d’art ou crèvent les pneus des véhicules 4×4. Ces militants écologistes d’un nouveau genre sont prêts à tout pour faire entendre leur voix face à ce qu’ils appellent l’inaction climatique ».
« L’inaction climatique » – sous-entendue, des pouvoirs publics – est attribuée ici au discours des militants, permettant à la chaîne de maintenir l’idée à distance. « L’urgence climatique » est, en revanche, présentée comme une évidence, qui n’a pas besoin d’être attribuée à un locuteur quelconque. Elle fonctionne comme un référent social : l’équipe de journalistes part du principe que tout le monde comprend ce que cela signifie et adhère à cette idée.
Pourtant, l’« urgence climatique » n’est pas le « réchauffement », le « changement » ou le « dérèglement climatique », l’expression dépasse la simple description du phénomène : l’idée de l’urgence donne à l’expression une valeur performative. Plus concrètement, parler d’urgence climatique c’est postuler l’urgence à agir.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ». Abonnez-vous dès aujourd’hui.
Comment l’expression s’est-elle démocratisée ? Que dit-elle de notre rapport à l’action environnementale ? Invoquer sans cesse « l’urgence climatique » a-t-il permis le passage à l’action présupposé par l’expression ?
Pour répondre à ces questions, je me suis intéressée à la circulation de l’expression dans les médias, les discours militants et politiques. Et en particulier à à ses premières apparitions dans la presse française : j’ai donc analysé les 150 articles parus entre la fin des années 1990 et 2008 qui comportaient « urgence climatique ». Cela permet d’identifier les premiers énonciateurs du terme, ainsi que les transformations de sens et les appropriations subis par l’expression à mesure de sa circulation.
Ce cadrage du problème climatique comme une urgence est tout sauf anodin. Il ne s’est pas imposé naturellement dans le débat public et résulte en fait d’un travail mené par des groupes d’acteurs afin d’obtenir des réponses de la part des pouvoirs publics.

Une expression d’abord consacrée aux épisodes météorologiques extrêmes
L’urgence climatique apparaît pour la première fois dans la presse française en 1997. Avant qu’elle ne s’intègre durablement au discours public dès 2019, ses usages demeurent rares, à l’exception de quelques pics d’apparitions discontinus (2009, 2015, 2018), tributaires de contextes particuliers.
Avant 2006, ses usages, exceptionnels, sont pour la plupart réservés à des épisodes météorologiques extrêmes, caractéristiques du traitement médiatique des questions environnementales sans mise en perspectives des causes de ces dérèglements.
En juillet 2003 par exemple, un article de Libération sur les pertes subies par les éleveurs à cause de la canicule mentionne « l’urgence climatique prise en compte par le ministre de l’Agriculture en nommant un « monsieur Sécheresse » en la personne de Pierre Portet, ingénieur général de l’agriculture ». L’urgence climatique due à la sécheresse estivale anormale est ici circonstancielle et localisée.

Un usage pour se démarquer et se positionner
Elle est également utilisée, dans quelques rares cas, pour désigner l’urgence du changement climatique par des personnalités publiques et des partis politiques. Ces derniers ne sont pas exclusivement étiquetés écologistes ou appartenant à l’opposition. On peut notamment citer le parti Génération Écologie, puis Greenpeace en 2005, Al Gore, WWF, le Réseau Action Climat et France Nature Environnement en 2006, mais aussi le ministre de la Recherche de Chirac en 2001.
Dès ces premiers usages pourtant épars, l’expression remplit des fonctions idéologiques et stratégiques : elle permet à ceux qui l’emploient de se distinguer et de se positionner.
Ainsi, lorsque le ministre de la Recherche de Jacques Chirac, Roger-Gérard Schwartzenberg, l’utilise pour se féliciter du lancement d’un satellite en 2001, c’est une manière de s’inscrire dans la stratégie présidentielle de l’auteur du célèbre : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », Chirac étant le premier président à faire de l’écologie un sujet de politiques publiques.
D’autre part, c’est aussi une façon de justifier le programme de recherche qu’il parraine et dans lequel s’inscrit le lancement de ce satellite de surveillance des océans. Évoquer l’urgence climatique lui permet de cadrer un problème à la fois localisé et relié au changement climatique, auquel le programme répond. Dans un des articles reprenant les communiqués du ministre, « l’urgence climatique » perd ensuite ses marques de citation, attribuant par défaut l’expression au journaliste. Un indice que l’expression commence déjà à s’intégrer dans le discours général.
Se positionner sur l’urgence est aussi un enjeu pour les écologistes d’opposition. En campagne en 2006, France Gamerre, présidente de Génération Écologie, associe l’expression à l’urgence énergétique dans une interview reprenant les termes du débat « urgence politique, urgence climatique et urgence santé » organisé par son parti en août 2005. De quoi lier les enjeux économiques et environnementaux, mais aussi extraire l’écologie d’un positionnement bourgeois. Cette rhétorique lui permet de se présenter comme une candidate différente.
Elle est suivie, quelques mois après, par sa concurrente la plus proche, Dominique Voynet, pour les Verts. Elle ajoute ce sujet à sa campagne en évoquant l’urgence dans un discours au Conseil national des Verts en mars, puis en meeting et dans une interview télé en avril, illustrant la rapidité des phénomènes de mise à l’agenda en période électorale.
En 2007 le thème intègre durablement le discours des Verts, en témoigne notamment une lettre ouverte, parue dans Libération en juin et signée par de nombreux cadres du parti, qui déclare :
« Nous avons besoin de vous pour mettre les Verts français à la hauteur des enjeux de l’urgence écologique ».

Les ONG s’en emparent pour politiser l’urgence
Pour les ONG, actrices majeures de la publicisation de l’expression – c’est-à-dire, le fait de la porter à la connaissance du public –, celle-ci constitue un outil de politisation.
En 2005, dans sa campagne contre l’implantation du réacteur ITER à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, Greenpeace mobilise l’urgence climatique pour décentrer la critique.
Plutôt que de porter seulement sur le choix du site, elle porte désormais plus globalement de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. L’expression est très efficace, puisqu’elle oppose la temporalité longue d’une technologie en phase de test et la situation de danger imminent appelant une réaction immédiate.
Puis d’autres organisations du climat (Agir pour l’Environnement, France Nature Environnement, Réseau Action Climat et le WWF en 2007), l’utilisent à leur tour. En juin 2007, elles lancent la campagne « Urgence climatique chauffe qui peut ! » réclamant la réglementation des émissions de CO2 des voitures.
Outre les ONG, quelques personnalités publiques se font lanceuses d’alerte sur le climat et entrepreneuses de la cause de l’urgence. Al Gore et sa vérité qui dérange contribuent à la publicisation de l’urgence, préférant cependant l’expression « planetary emergency » que l’on traduit par « urgence planétaire ».
En France, Nicolas Hulot, alors animateur populaire d’Ushuaïa Nature alerte sur « l’urgence écologique » dans une lettre ouverte au Président en 2006, puis dans son pacte écologique de janvier 2007.
« Face à l’urgence climatique, les discours ne suffisent pas » conclut cette vidéo promotionnelle de Greenpeace France.
Quand l’urgence climatique devient mainstream
Mais l’intensification des usages de l’expression en 2007 doit bien davantage à l’implication des journalistes, qui jouent un rôle central de prescripteurs de l’information. Le contexte était celui d’une actualité environnementale intense (sortie du rapport du GIEC, G8 et ses contre mobilisations, Grenelle de l’environnement, attribution du prix Nobel de la paix à Al Gore et au GIEC…).
Dans bien des cas cependant, l’expression est soit une citation implicite, soit une attribution à des locuteurs qui ne l’ont pas vraiment utilisée. Un article de Ouest France prête, à tort, par exemple, à Angela Merkel l’usage de l’expression dans son discours de préparation au G8 de 2007 devant le Bundestag en écrivant :
« Alors que la chancelière allemande Angela Merkel veut faire de ce sommet […] un “signal fort sur l’urgence climatique” […] »
Elle n’évoque en fait qu’un « signal important » (« ganz wichtiges Signal ») et « les questions mondiales urgentes de notre époque », (« die drängende globale Fragen unserer Zeit ») dont la protection du climat fait partie.
Ce désordre dans les citations révèle l’intégration de l’expression au langage commun, parachevée par les journalistes. Dès lors que sa paternité n’est plus un enjeu, c’est que l’expression a gagné un caractère consensuel.
L’urgence climatique s’installe, en parallèle, dans le discours des politiques au pouvoir. La conférence de Paris, puis le Grenelle de l’environnement en 2007, ont un poids non négligeable dans la mise en circulation de l’expression. Elle représente toujours un enjeu de positionnement pour les politiques.
Cela apparaît de manière particulièrement claire dans les travaux de préparation du Grenelle à l’hémicycle. Pendant un débat à l’Assemblée Nationale en octobre, la notion circule d’une prise de parole à l’autre, chaque député de groupes politiques différents essayant d’imposer sa définition et s’en réclamant.
La notion d’urgence est finalement entérinée par le premier article de la loi Grenelle 1 en 2009, sous la forme imposée par Nicolas Hulot avec son pacte de 2007 et reprise par Nicolas Sarkozy : « l’urgence écologique ».
Une expression au succès ambivalent
Circulant entre le discours des organisations du climat, ceux des politiciens et des journalistes, l’expression fait la preuve de son intertextualité. Elle illustre la manière dont les discours se nourrissent les uns les autres. Employée simultanément par une variété d’acteurs poursuivant des buts différents, elle pénètre plus facilement dans le langage courant. Mais elle échappe de fait à un marquage idéologique clair et donne lieu à une dispersion qui contribue à l’appauvrir, quitte à faire rimer banalisation avec dépolitisation.
Le paradoxe de l’expression se dessine alors : tandis que l’abondance de ses apparitions témoigne de sa médiagénie, c’est-à-dire la compétence d’un objet médiatique à circuler dans l’espace social, sa persistance dans les discours, près de quinze ans après ses premières apparitions, souligne sa faiblesse performative.
Beaucoup utilisée par les mouvements écologistes contemporains, car considérée comme en accord avec la science et mobilisatrice, son usage n’est pas exempt de dangers, d’après les militants. Certains estiment son inefficacité due à son ancienneté :
« C’est vrai que ça fait dix ans qu’on parle d’urgence » constatait une militante écologiste avec qui j’ai pu conduire un entretien.
D’autres soulignent l’angoisse et la démobilisation qu’elle peut susciter. Ainsi que le risque d’appropriation par des ennemis politiques, ce qui montre qu’elle demeure un enjeu de positionnement malgré sa banalisation.
L’expression témoigne également de l’entrée de la question des temporalités dans les discours écolos militants, avec la collapsologie notamment. Mais elle masque les inégalités profondes devant le droit à l’avenir : l’urgence n’est pas la même pour tout le monde.
En fin de compte, l’expression « urgence climatique » semble avoir échoué, pour l’instant, à transformer de manière significative l’action publique : l’enjeu écologique résiste décidément à la performativité du langage. On ne peut d’ailleurs que déplorer l’absence d’engagements assortis aux déclarations d’État d’urgence climatique.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, ne cesse de recourir à des formules de plus en plus alarmistes dans l’espoir de provoquer un sursaut. Il déclarait en septembre 2023 :
« l’humanité a ouvert les portes de l’enfer » en ne voulant pas se détourner de son addiction aux énergies fossiles.
De leur côté, certains collectifs militants, à l’instar de Dernière Rénovation optent pour la rhétorique du compte à rebours : on se souvient de l’action d’Alizée, militante du collectif qui s’était attachée au filet du court de tennis de Roland-Garros en 2022. Son t-shirt affichait en anglais « il nous reste 1028 jours ».
Les formules rivalisent pour dénoncer les responsables, nous exhorter collectivement et obliger nos dirigeants à agir à la hauteur de l’imminence du désastre, mais sans trouver de répondant.
Iris Viloux, doctorante au Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias (CARISM), Université Paris-Panthéon-Assas
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Urgence climatique : en parler, sans paralyser
à lire dans l’édition de La Croix du vendredi 3 mai 2024 et sur la-croix.com
Longtemps perçu comme une question abstraite, le réchauffement climatique produit des effets tangibles. Pour ceux qui informent sur ces effets se pose la question de la façon dont parler de la crise. Au-delà des discours, le choix du vocabulaire à adopter divise les linguistes.
Climat : derrière les objectifs chiffrés, une édulcoration des connaissances scientifiques ?

Marc Delepouve, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Grâce au travail du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), les gouvernements n’ont eu d’autre choix que de prendre au sérieux le changement climatique et ses conséquences. Leurs décisions s’appuient ainsi sur les rapports du groupe d’experts, qui évaluent l’état des lieux des savoirs scientifiques et tracent plusieurs scénarios d’évolution future du climat.
Pour autant, ces décisions du monde politique répondent-elles fidèlement à l’ampleur du risque climatique ? Dans ma thèse, j’ai étudié les travaux du GIEC et leur utilisation par le monde politique.
J’en ai tiré une conclusion : les politiques climatiques reposent sur une simplification extrême du savoir scientifique, réduite à quelques chiffres. Et c’est dangereux, car cela va de pair avec une sous-estimation des risques.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ». Abonnez-vous dès aujourd’hui.
La difficile traduction des évaluations scientifiques en objectifs chiffrés
La COP26, tenue en 2021, s’est conclue par le Pacte de Glasgow où, pour la première fois, un accord politique international s’appuyait sur de tels chiffres. Cet accord portait sur :
- l’objectif d’une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 45 % en 2030 par rapport à 2010,
- et sur l’objectif de neutralité carbone en 2050 (c’est-à-dire, des émissions nettes de CO2 nulles, autrement dit la compensation des émissions anthropiques de CO2 par une captation d’un montant équivalent).
Ces deux objectifs devenaient, dès lors, la référence adoptée par les politiques au plan international en vue de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 °C en 2100 par rapport à l’époque préindustrielle. Le pacte de Glasgow complétait ainsi l’accord de Paris qui avait introduit l’objectif de 1,5 °C, aux côtés de celui de 2 °C, déjà introduit en 2009 lors de la COP15 tenue à Copenhague.

Deux ans plus tard, la COP28, tenue à Dubaï, reprenait dans sa conclusion l’accent mis à Glasgow sur l’objectif 1,5 °C, et en faisait la mise à jour sous la forme de trois objectifs chiffrés :
- « réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43 % entre 2019 et 2030 […] »
- « […] de 60 % entre 2019 et 2035 […] »
- « […] et parvenir à des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles d’ici à 2050 ».
Les deux objectifs politiques de réduction d’émission de CO2 de Glasgow trouvent leur source dans le rapport spécial sur un réchauffement de 1,5 °C publié en octobre 2018 par le GIEC. Les trois objectifs de Dubaï, quant à eux, trouvent leur source dans le 6ᵉ rapport d’évaluation du GIEC, dont les différentes parties ont été publiées entre 2021 et 2023.
Toutefois, une lecture de ces rapports du GIEC permet de constater que ces objectifs ne sont qu’une libre traduction politique de scénarios climatiques de ces rapports. Comprendre : ils n’en sont nullement une traduction scientifique.
Le problème de cette traduction politique, c’est qu’elle omet de prendre en considération que les modélisations climatiques utilisées pour établir ces scénarios laissent de côté des phénomènes potentiellement amplificateurs du réchauffement climatique.

Des « bombes climatiques » qui ajoutent à l’imprévisibilité
Parmi ces phénomènes, trois ont particulièrement attiré mon attention, car ils présentent le risque d’aggraver le changement climatique. Ce sont :
- la fonte de glaciers polaires,
- la désagrégation d’hydrates de méthane des fonds marins (un hydrate de méthane est constitué d’une molécule de méthane et d’une cage de glace où cette molécule est piégée)
- et le bouleversement du vivant marin.
Chacun de ces trois phénomènes est susceptible d’émettre massivement du méthane et du CO2 dans l’atmosphère. Chacun d’entre eux pourrait ainsi devenir la cause d’une accélération du réchauffement climatique, laquelle viendrait en retour intensifier ces phénomènes et leurs émissions de gaz à effet de serre, d’où une accélération supplémentaire du réchauffement. Il existe ici un risque réel de boucles de rétroactions positives – autrement dit, de cercles vicieux.
Dans ma thèse, j’ai montré pourquoi dès le XXIe siècle ces trois phénomènes pris dans leur ensemble, qui plus est combinés avec d’autres phénomènes non pris en compte par les scénarios, présentent le risque d’enclencher un emballement climatique. Pourtant, ces trois phénomènes sont totalement ignorés lors de l’élaboration des scénarios du GIEC. Cela en raison de leur haut niveau d’imprévisibilité et de la difficile quantification de leurs futures émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le bouleversement en cours de la vie dans les mers et océans est particulièrement éclairant. Il pourrait avoir des conséquences importantes sur le climat, car le rôle du vivant marin est majeur sur la composition de l’atmosphère et en particulier pour réguler la composition en CO₂ de l’air. Les mers et océans subissent en effet de plein fouet le réchauffement climatique ainsi qu’un ensemble d’autres perturbations anthropiques, comme l’acidification. La combinaison de ces perturbations crée un environnement du vivant marin inédit, si bien que ce dernier entre en zone inconnue. Son évolution d’ici à la fin du XXIe siècle est largement incertaine et présente le risque d’occasionner un surplus important de GES dans l’atmosphère.

La quantophrénie, ou les limites de la quantification
Pourquoi le politique néglige-t-il ces éléments ? D’abord en raison de la méthode de décision par consensus entre les États. Mais aussi, d’après moi, en raison d’un biais quantophrénique. La quantophrénie est un biais de la pensée aujourd’hui très présent au sein des sociétés humaines, en particulier chez les décideurs politiques et économiques, mais aussi chez de nombreux scientifiques.
Ce terme trouve son origine dans « Fads And Foibles In Modern Sociology And Related Sciences ». Cet ouvrage, publié en 1956, a pour auteur le sociologue Pitrim Sorokin, fondateur du département de sociologie de l’Université de Harvard.
J’ai opéré un élargissement de son usage hors des Sciences humaines et sociales (SHS), et l’ai définie comme :
« la tendance à limiter les représentations des phénomènes ou objets aux seules représentations quantifiées, à nourrir les processus de décision politique de ces seules représentations quantifiées, et à largement utiliser des critères quantitatifs comme outils de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques et du travail ».
Cette tendance, qui se déploie au détriment des formes de savoir non quantifié, a été documentée par de nombreux spécialistes. Quelques exemples, de façon non exhaustive :
- Ida Hoos démontrait en 1979 que les modèles quantifiés utilisés pour évaluer des technologies ne prenaient pas en considération les implications institutionnelles, sociales et sociétales, et n’étaient pas fiables pour évaluer l’avenir incertain.
- En 1993, Alain Desrosières exposait le développement de l’usage des outils statistiques et probabilistes au cours de l’histoire moderne.
- En 2008, Wendy Nelson Espeland et Mitchell Nelson observaient les conséquences politiques, sociales et culturelles de la quantification des phénomènes sociaux.
- En 2011, j’ai publié un ouvrage (2011) qui s’intéressait aux conséquences de la quantophrénie en termes de déshumanisation des rapports sociaux, de rapports de domination et d’absence de prise en compte de l’imprévisible.
- En 2015, Alain Supiot explorait l’usage des nombres dans la gouvernance des populations, laquelle se substitue au gouvernement et fait surgir des liens d’allégeance oligarchique.
- Plus récemment en 2019 et 2020, David Demortain explorait la quantification de l’action publique et Olivier Martin dressait une histoire de la quantification, de ses usages et de ses implications sur les sociétés humaines, de la préhistoire à nos jours, du comptage du bétail à l’algorithmique.

Le « reste causal » pour penser l’imprévisible
En effet, toute quantification repose sur un ou plusieurs aspects d’un phénomène ou objet étudié. Elle laisse donc sur le côté les aspects non pris en compte. C’est pourquoi j’ai introduit dès ma thèse la notion de reste associé à une quantification. Puis je l’ai déclinée en une notion de « reste causal », que j’ai appliquée aux scénarios du GIEC. Ce « reste causal », associé à un scénario chiffré d’évolution future d’un phénomène donné, regroupe l’ensemble des phénomènes qui influenceront ou pourraient influencer cette évolution, mais qui ne sont pas pris en compte par le scénario.
Il est à noter que la mission du GIEC est d’évaluer la littérature scientifique disponible. Ainsi, les scénarios dits « du GIEC » ne sont pas élaborés par le GIEC, mais par des institutions de recherche. Le reste causal associé résulte de contraintes méthodologiques.
Dans le cas de ces scénarios, le reste causal contient un certain nombre de phénomènes identifiés scientifiquement, imprévisibles dans leur ampleur et leur temporalité, porteurs du risque d’une amplification du réchauffement dont les dommages pourraient être graves et irréversibles. Parmi ces phénomènes se trouvent les trois sources naturelles de gaz à effet de serre présentées plus haut.

Ce que cela signifie pour les politiques climatiques
Les objectifs politiques des COP26 et 28 constituent des avancées notables du consensus de l’ensemble des nations. Ces objectifs sont chiffrés, ce qui n’est guère surprenant dans le contexte de quantophrénie particulièrement prégnant dans le champ politique. Toutefois, ils reposent sur une quantification qui ne prend pas en considération un reste causal chargé d’imprévisibilité, non quantifiable et porteur d’une menace majeure.
Une politique d’atténuation du changement climatique au plus proche de l’ensemble des connaissances scientifiques disponibles doit prendre en considération les phénomènes du reste causal associé aux scénarios du GIEC. Par conséquent, une telle politique doit viser des objectifs de réduction des émissions de GES plus ambitieux que ceux de la COP28. De plus, elle doit assurer une protection des mers et océans et, au plus vite, réduire les perturbations anthropiques de ces derniers.
Prioriser l’action sur les points les plus imprévisibles, tout en prenant en compte les scénarios climatiques publiés par le GIEC, ce sont les conditions nécessaires pour réduire au maximum le risque d’un emballement climatique, dont les dommages pour l’humanité seraient irréversibles et d’une extrême gravité.
Marc Delepouve, Chercheur associé au CNAM, Docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.



