Comment (ré)concilier éducation et durabilité, fonction publique et transition écologique, administration de l’état et respect du vivant ? Pierre-Henry Dodart, Administrateur de l’État engagé pour la transition écologique, a accepté de répondre aux neufs questions essentielles pour Cdurable. Ses réponses nous invitent à réfléchir et agir avec empathie envers le vivant, humain et non humain. J’aime l’expertise et l’humilité des présentations sur LinkedIn d’outils et ressources qu’il propose pour mettre l’éducation, la formation et la recherche au service d’une transition réussie qui ne soit pas seulement une adaptation, mais une œuvre commune, un chemin défini ensemble.
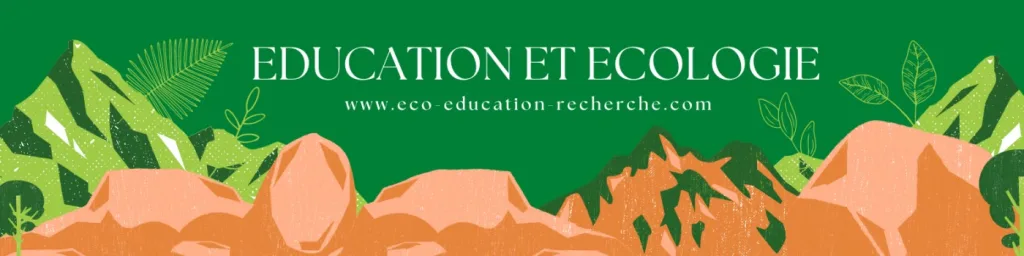
Écologie : comment donner aux jeunes le pouvoir d’agir ?
Pour 82 % des 18-30 ans, avoir un emploi qui respecte l’environnement est un critère important, selon une enquête de Toluna et Harris Interactive. Mais comment préparer et former les jeunes aux enjeux de la transition écologique ? Pierre-Henry Dodart, alors chargé de mission enseignement aux enjeux environnementaux et de durabilité au CGDD, et François Taddei, président du Learning Planet Institute, répondent à SMART IMPACT, Le magazine de l’économie durable et responsable.
7 savoirs fondamentaux que l’éducation devrait intégrer pour mieux préparer les générations futures
Dans ce texte visionnaire publié en 1999, Edgar Morin identifiait sept savoirs fondamentaux que l’éducation devrait intégrer pour mieux préparer les générations futures à un monde incertain, interdépendant, et complexe. Plus de 20 ans plus tard, ce texte n’a rien perdu de sa pertinence… bien au contraire.
- 1️⃣ Apprendre à reconnaître nos propres aveuglements : L’éducation doit nous aider à comprendre ce qu’est la connaissance humaine. A la fois fragile, sujette à l’erreur, à l’illusion ou encore au conditionnement culturel. Il faut armer les esprits contre la manipulation, mais aussi contre leurs propres automatismes cognitifs
- 2️⃣ Relier plutôt que séparer : Nos savoirs sont trop souvent fragmentés. Il faut enseigner la complexité, les liens entre les disciplines, les interactions entre les parties et le tout. Ce n’est qu’en comprenant les contextes que l’on peut agir avec pertinence.
- 3️⃣ Enseigner ce que signifie être humain : L’humain est à la fois biologique, culturel, social, affectif. Or, l’école disloque cette unité. Morin appelle à une approche intégrée de la condition humaine, qui donne à chacun conscience de sa singularité et de son appartenance au collectif.
- 4️⃣ Reconnaître notre identité terrestre : Nous formons une communauté de destin sur une planète unique. Il devient indispensable d’enseigner l’histoire de notre ère planétaire, les interdépendances globales, mais aussi les inégalités et les conflits qui en découlent.
- 5️⃣ Apprivoiser l’incertitude : Loin des illusions de maîtrise, l’école devrait préparer à l’inattendu, au changement, au doute. Face aux défis climatiques, technologiques ou politiques, former à la stratégie, à l’adaptation, devient essentiel.
- 6️⃣ Apprendre la compréhension : Comprendre l’autre, c’est aussi comprendre ses propres limites. Contre l’égocentrisme, le racisme, les replis identitaires, l’éducation doit développer une éthique de la compréhension, condition d’une paix durable.
- 7️⃣ Fonder une éthique du genre humain : Loin des leçons de morale, Morin plaide pour une « anthropo-éthique » : reconnaître en chacun sa triple appartenance à une société, à une espèce humaine, et à une planète partagée. C’est ainsi que peuvent émerger une démocratie vivante et une citoyenneté terrestre.
Ce texte n’est pas un programme figé. Il est une invitation à repenser notre rapport au savoir, à l’autre et au monde. Une boussole précieuse pour toutes celles et ceux qui croient encore en une éducation capable de transformer l’avenir.
Façonner un avenir durable avec la fonction publique
Œuvrer à façonner un avenir où éducation et durabilité se rencontrent pour développer chez chacun la capacité de penser et d’agir avec empathie et responsabilité envers le vivant et la santé publique.
L’intégration des mots « éducation » et « durabilité » dans sa présentation souligne les fondements de sa mission : encourager une conscience sociale et environnementale et promouvoir la durabilité à travers l’éducation. Ces termes encapsulent notre engagement commun vers un futur où les individus et les collectifs sont conscients de leurs impacts et agissent de manière responsable.
Le terme éducation est au cœur de sa démarche, qui vise à créer les conditions de développement des connaissances, des aptitudes et des attitudes qui encouragent des modes de pensée et d’action responsables, empathiques et respectueux du vivant et de la santé publique. Il représente l’outil par lequel nous pouvons transformer les comportements individuels et collectifs pour faire face efficacement aux défis sociaux et environnementaux.
Durabilité définit l’objectif de cette démarche éducative. Elle incarne l’ambition d’un équilibre entre les besoins actuels et la capacité des futures générations à répondre aux leurs, promouvant des manières de vivre qui permettent un équilibre environnemental et une équité sociale. C’est une approche qui intègre l’empathie et la responsabilité dans toutes les sphères d’action, visant une coexistence harmonieuse entre l’humanité et le reste du vivant.
Lorsque « éducation » et « durabilité » se rencontrent, ils forment un pilier sur lequel s’appuyer pour bâtir une société capable de penser, planifier et agir de manière durable.
Cette alliance cherche à équiper les individus et les collectifs des compétences nécessaires pour naviguer dans les complexités de notre monde avec une conscience aiguisée de leur rôle dans la promotion de la durabilité. Elle guide nos efforts vers un avenir où l’ensemble de la société humaine contribue activement à la santé des écosystèmes et au bien-être des générations actuelles et futures.
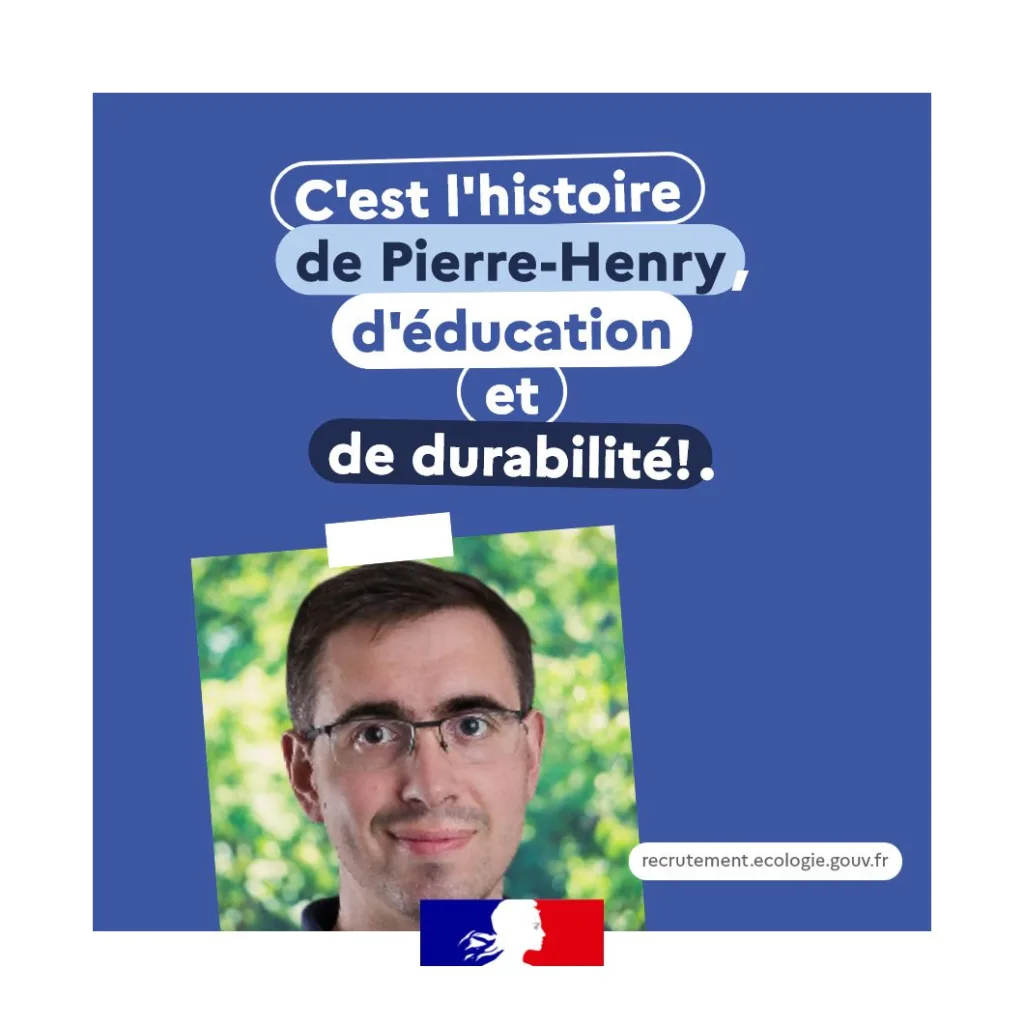
Qui est Pierre-Henry Dodart ?
Chargé de mission enseignement aux enjeux environnementaux et de durabilité

Manager expérimenté avec près de 20 ans d’expérience à l’interface du secteur public et privé, il a une expertise approfondie en gestion de projets complexes, en politiques de ressources humaines et en droit de la fonction publique.
Son expérience, répartie entre des fonctions de haut-fonctionnaire et de consultant, lui a permis de piloter des réformes structurantes tout en développant une vision stratégique des enjeux liés à la transition écologique et à la durabilité.
Fort d’une solide maîtrise des outils numériques et d’une capacité reconnue à animer des équipes pluridisciplinaires, je suis également un praticien confirmé du dialogue social à haut niveau.
Désormais, il souhaite accélérer la conception et la mise en œuvre de politiques publiques répondant aux défis écologiques contemporains, en intégrant ces problématiques dans une approche globale, cohérente et innovante.
Questions Cdurable à Pierre-Henry Dodart
Questions Cdurable !
ou c’est pas durable ?
Au delà des communiqués, qui ne présentent souvent que le « meilleur », et du développement durable, qui ne fait que tenter de réduire les impacts négatifs d‘une croissance volumique, nous nous intéressons, 20 ans après la création de Cdurable.info, aux questions essentielles. Alors Cdurable ou pas ? 9 questions qui nous invitent à Comprendre pourquoi Agir & Coopérer avec le vivant, Cdurable !
1 – Quelle est la nature de ma relation avec le vivant ?
Ma relation avec le vivant est traversée par des tensions. Intellectuellement, je pense avoir compris que tout est lié, que l’humain ne peut être pensé en dehors du vivant dont il procède, mais une part de moi continue à raisonner comme s’il en était distinct. C’est un héritage culturel profondément ancré, celui d’un humanisme qui a permis d’émanciper, d’éduquer et de protéger, et auquel je reste attaché, presque instinctivement.
J’en perçois pourtant les limites, car en plaçant l’humain au centre, nous avons parfois oublié la manière dont il est relié au reste du monde.
J’essaie désormais de concilier le respect de ce que cette tradition a construit et la nécessité de l’ouvrir à une conscience écologique plus large. J’en viens à penser que notre « juste rapport au vivant » pourrait naître de cet équilibre fragile entre la lucidité de notre condition, l’humilité de notre présence au monde et la fidélité à l’élan humaniste qui nous relie les uns aux autres.
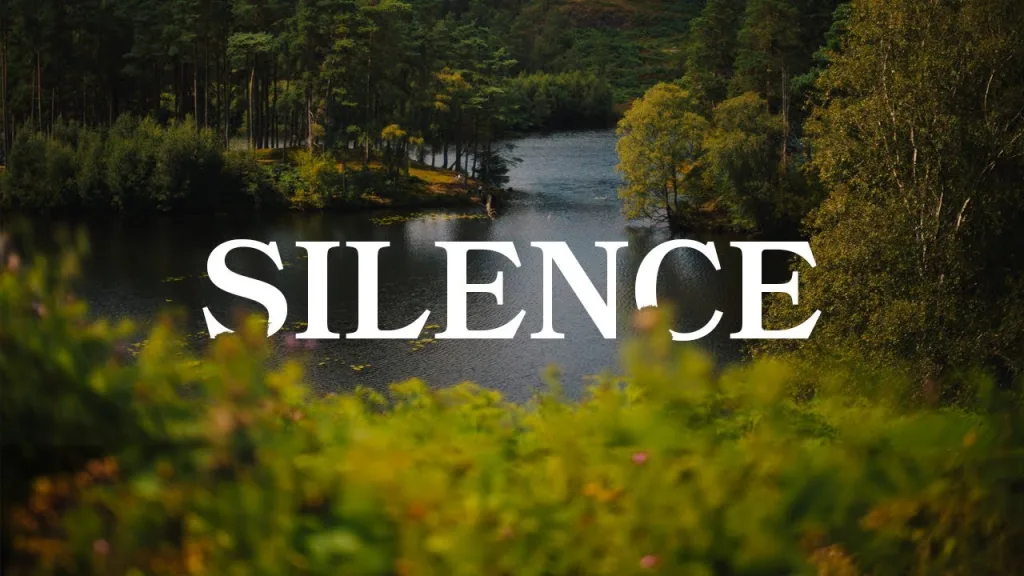
2 – Quels sont mes besoins et choix d’alimentation ?
Mes choix d’alimentation traduisent une tension entre les habitudes sociales qui m’entourent et le souci de préserver le vivant.
Je vis dans une société où le café, l’apéritif ou le barbecue tiennent une place importante dans nos manières d’être ensemble. Je ne suis pas particulièrement attaché à ces pratiques, mais je comprends leur rôle dans la convivialité et ce qu’elles disent de notre besoin de lien.
Dans mon quotidien, j’essaie simplement de trouver un équilibre entre ces usages collectifs et mes propres repères. Je mange très peu de viande, j’évite les produits transformés, je choisis des aliments biologiques parce que j’en ai les moyens, je ne bois ni café ni jus, et je m’interroge sur la place constante de l’alcool dans nos moments de rencontre.
Ces choix ne relèvent pas d’une posture morale, ils expriment un questionnement croissant à ce qui nous relie au vivant (et une affaire de goût !).
Par ailleurs, je ne me retrouve pas dans les approches qui réduisent l’alimentation à un calcul carbone, car manger n’est pas une équation mais une relation.
Ce qui me semble essentiel, c’est la qualité de ce lien avec ce que nous mangeons, la reconnaissance de ce qui nous nourrit et la possibilité d’inventer d’autres formes de convivialité, plus sobres, mais tout aussi « humaines ».

3 – Quel est mon type d’habitat actuel et idéal ?
J’habite un appartement trois pièces avec ma famille dans un immeuble des années soixante, un habitat collectif assez simple, fonctionnel, à taille humaine. C’est sans doute ce qui me convient le mieux. Je n’ai jamais eu le désir d’un grand logement parce que je n’ai pas envie de passer ma vie à faire le ménage, ni d’une maison avec jardin parce que ça demande aussi beaucoup d’entretien.
L’habitat collectif me semble être une manière équilibrée de vivre, à la fois pour la sobriété qu’il permet et pour les relations qu’il rend possibles.
L’idéal, pour moi, ne serait pas très différent de ce que je vis déjà, mais un peu plus vivant lui aussi avec par exemple des sources d’énergies renouvelables, une cour plus végétalisée, des espaces et matériels partagés…

4 – Quelle activité physique favorise mon bien-être et ma santé
L’activité physique qui me fait du bien reste sans doute la plus simple, marcher.
Marcher me permet de penser, d’observer, de respirer autrement.
C’est une manière d’être dans le monde sans chercher à le dominer, de retrouver un rythme plus juste, celui du corps et du dehors. Mais la plupart du temps, mon activité physique se confond avec ce que je fais chaque jour, marcher pour aller faire les courses et aller au travail, laver les vitres, étendre le linge, monter les escaliers, bouger parce que la vie le demande. Cette activité discrète et quotidienne me semble la plus juste car elle entretient simplement le lien entre le corps et le monde qui m’entoure.
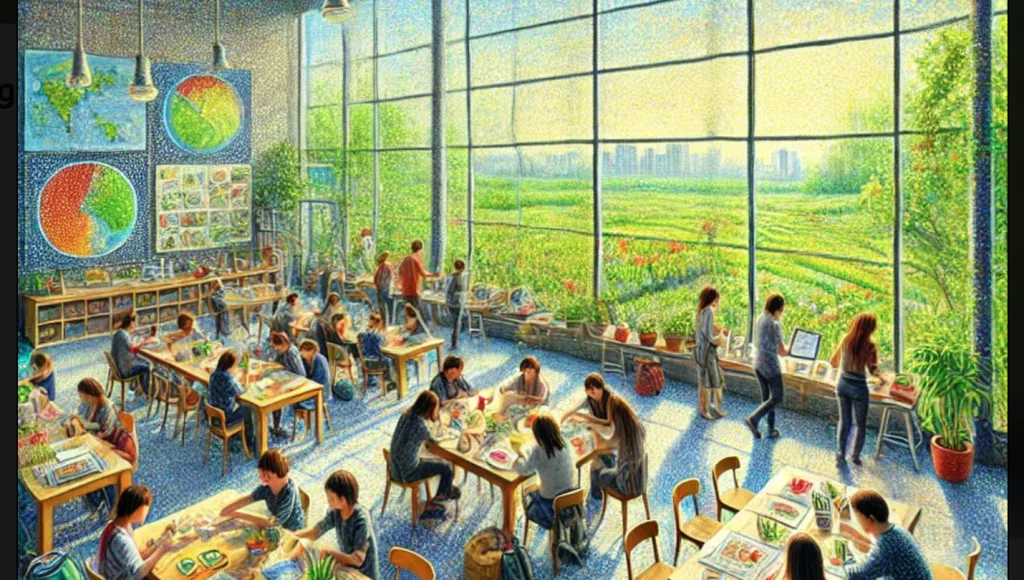
5 – Quels savoirs m’ont permis de comprendre comment agir ?
Je ne peux pas vraiment répondre à cette question car je ne suis pas encore sûr de comprendre comment agir. Je crois avoir appris pas mal de choses, j’ai lu, échangé, observé, et pourtant je reste souvent (principalement) dans le doute.
Ce que je crois savoir vient d’un mélange de connaissances, d’expériences et, probablement plus à la marge, de ressentis, autant physiques qu’émotionnels.
J’ai trouvé des repères dans certaines approches, comme la résonance de Rosa ou la communication non violente de Rosenberg, qui m’aident à penser la relation plutôt que le résultat. Mais cela ne suffit pas à me donner la certitude d’agir juste. Alors j’essaie, je fais, parfois sans savoir si c’est la bonne direction. Peut-être que comprendre et agir ne sont pas deux étapes distinctes mais un même mouvement, fait d’essais, d’erreurs et d’attention.
En attendant de savoir vraiment comment agir, je continue simplement à le faire, du mieux que je peux.
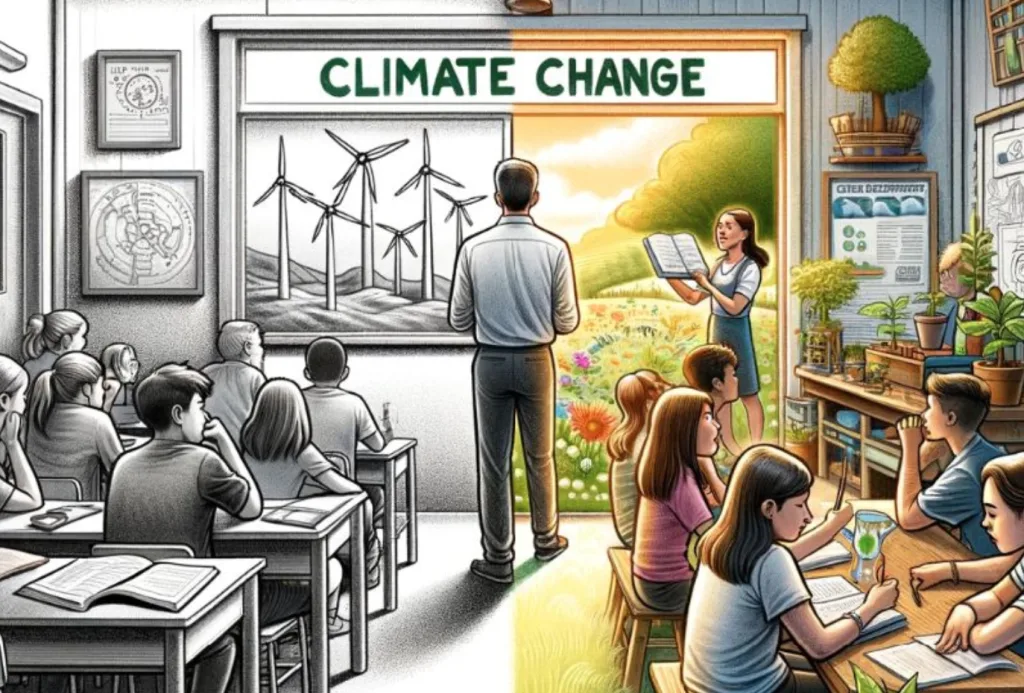
6 – Quel est le sens que je donne à mon travail ?
Le sens que je donne à mon travail tient aussi au fait que j’ai, aujourd’hui, le sentiment d’exercer le métier qui me correspond. J’évolue dans un écosystème stimulant, entouré de collègues engagés et bienveillants, avec lesquels il est possible de réfléchir, d’expérimenter et de construire.
Ce climat rend le travail profondément vivant. Je travaille sur les politiques publiques d’éducation à la transition écologique et sur leur rôle dans l’accompagnement de la transformation de l’action publique.
C’est un champ exigeant et passionnant, qui oblige à penser ensemble la formation, la culture administrative et les mutations sociales et environnementales en cours. Ce travail repose sur le dialogue et la coopération, et me permet de relier la réflexion à l’action, les idées aux réalités.
Je ne sais pas toujours ce que produisent mes actions, mais j’ai la conviction que ces expériences collectives, faites de confiance et de dialogue, participent à quelque chose de plus vaste que moi, et c’est sans doute là que réside leur véritable sens.

7 – Quelle énergie j’utilise pour mes usages et besoins ?
Je vis dans un appartement chauffé au gaz, avec un usage modéré de l’électricité et une attention quotidienne à la sobriété. Je ne cherche pas à tout optimiser, mais à comprendre ce que consommer veut dire. J’essaie de réduire mes besoins autant que possible.
L’énergie que j’utilise, c’est aussi celle du corps et de l’attention et ça renvoi à la question sur l’activité physique. Marcher plutôt que prendre la voiture, monter les escaliers, vivre à un rythme plus lent. À un autre niveau, l’énergie dont j’ai besoin est celle qui circule dans le travail collectif, dans les échanges, dans la confiance que l’on peut construire.
C’est sans doute cette énergie-là, humaine et relationnelle, qui me paraît la plus précieuse, car elle ne s’épuise pas quand on la partage ☺

8 – Quelle est mon implication personnelle pour l’intérêt général ?
Je trouve que la notion d’intérêt général, bien qu’au cœur de l’action publique, reste difficile à définir. En droit français, elle renvoie à « ce qui est pour le bien public », mais son contenu varie selon les époques, les contextes et les sensibilités. Historiquement elle est venue remplacer la notion de « bien commun » qui semble réapparaitre régulièrement. Cette indétermination n’est pas une faiblesse car elle permet à la société de redéfinir en permanence ce qui compte pour elle.
Mon implication personnelle s’inscrit dans cette dynamique. En tant qu’agent public, ma vie professionnelle est, par nature, liée à cette notion et je participe à une mission collective.
Aujourd’hui, j’essaie aussi de donner à cette mission un sens élargi, en y intégrant les enjeux écologiques et la responsabilité que nous avons à l’égard du vivant.
Mon travail autour des politiques d’éducation à la transition écologique vise justement à faire évoluer la manière dont les institutions se pensent et agissent dans ce cadre mouvant. Je ne crois pas détenir une réponse sur ce qu’est l’intérêt général, mais je cherche à contribuer à sa construction quotidienne, en cherchant à comprendre ce que servir veut dire aujourd’hui, dans un monde qui change.

9 – Quels sont mes liens de coopération et ma participation au bien commun ?
Comme pour l’intérêt général, j’ai du mal à définir clairement ce qu’est le bien commun. Je trouve que c’est une notion à la fois évidente et insaisissable, qui renvoie autant à ce que nous partageons qu’à la manière dont nous en prenons soin.
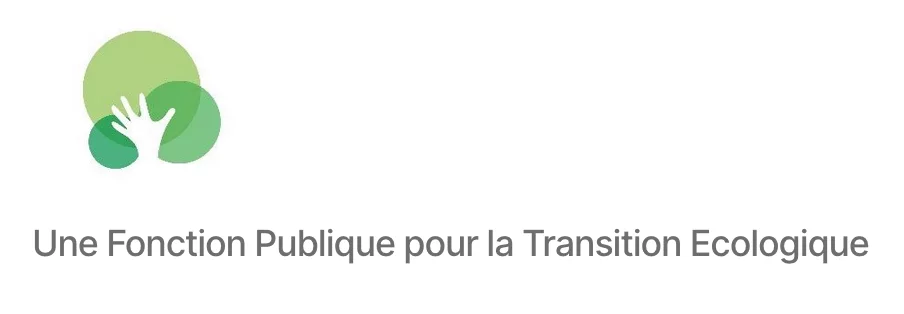
Mon engagement au sein de l’association Une Fonction publique pour la transition écologique s’inscrit dans cette recherche. J’y retrouve un esprit collectif, le goût du dialogue et la possibilité d’expérimenter avec d’autres ce que pourrait être une action publique plus attentive au vivant. Cet engagement, bénévole mais structurant, me relie à des personnes très engagées et m’aide à penser autrement la responsabilité de l’administration.
En dehors de ce cadre, je participe aussi à des initiatives autour de l’éducation, de la transition et de la vie locale.
Ces coopérations me rappellent que le bien commun ne se définit pas une fois pour toutes. Il se construit dans les liens que nous tissons, dans la confiance que nous accordons, et dans l’attention que nous portons aux autres.

10 – Carte blanche : quel est le message essentiel que vous souhaitez faire passer à nos visiteurs ?
S’il y avait un message à faire passer, ce serait peut-être celui d’une attention renouvelée à l’autre, surtout lorsqu’il ne pense pas comme nous.
Dans une période où tout semble s’accélérer, je crois qu’il devient essentiel de réapprendre à écouter, à comprendre avant de vouloir convaincre.
Les transformations dont nous avons besoin ne se décrètent pas, elles se construisent dans le dialogue, dans le doute partagé, dans la reconnaissance des différences. Mon souhait est que nous sachions créer les espaces où ces transformations peuvent advenir, sans chercher à tout maîtriser.
Il nous faut aussi oser poser des objets de discussion qui ne le sont pas encore, aborder collectivement ce que nous n’avons pas encore su nommer. Pour moi, c’est sans doute la condition d’une transition réussie qui ne serait pas seulement une adaptation, mais une œuvre commune, un chemin défini ensemble.
Éducation et transformation écologique : que dit la recherche ?
Le blog de Pierre-Henry Dodart :

Éducation au développement durable
Développer et faciliter les échanges autour des enjeux environnementaux dès le plus jeune âge et tout au long du parcours scolaire est fondamental pour l’éducation au développement durable. Dans cet objectif, le ministère met à disposition des enseignants, sa plateforme de ressources pour la classe.
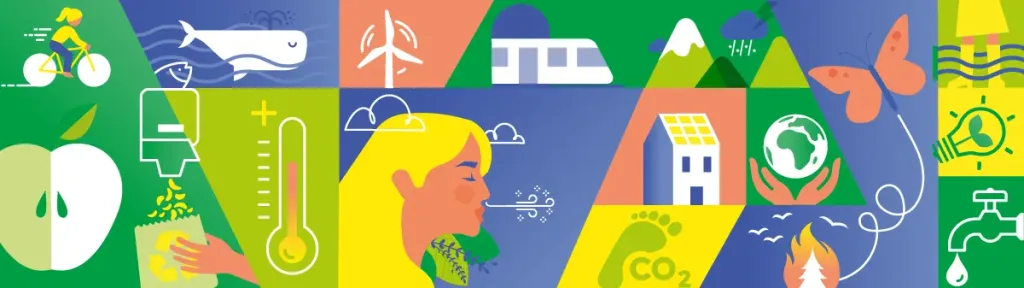
Coup de pousse : le podcast pour faire grandir nos enfants dans un environnement sain
Coup de pousse, c’est le nouveau podcast du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques sur l’environnement et la santé des enfants qui donne aux parents de bonnes pratiques pour faire grandir leurs enfants dans un environnement sain.


