Le World Energy Outlook 2008 publié par l’Agence Internationale de l’Energie le confirme : les émissions de CO2 n’avaient encore jamais été aussi élevées. Pire, elles devraient augmenter de 46% entre 2006 et 2030. Parallèlement, les experts prévoient que la production pétrolière diminuera à relativement court terme mais que la demande mondiale en hydrocarbures augmentera. La tension qui s’ensuivra sur prix les hydrocarbures incitera très probablement à remettre en cause les modes de production et de consommation d’énergie. Quelles sont aujourd’hui les alternatives?
L’emballement de la machine climatique
Notre modèle industriel s’est construit sur les bases d’une utilisation massive de pétrole, de gaz, de charbon. Leur combustion émet des gaz qui, en s’accumulant dans l’atmosphère, amplifient l’effet de serre. Le Groupe International d’Experts sur le Climat (GIEC) estime que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 70 % depuis la révolution industrielle [[Troisième rapport d’évaluation du GIEC 2001, disponible sur le site GIEC ]]. Par conséquent, alors que a température avait augmenté en moyenne que de 0.74°C au cours du dernier siècle, le réchauffement est de 0.13°C par décennie depuis ces cinquante dernières annéee [[Quatrième rapport d’évaluation du GIEC 2007, disponible sur le site du GIEC ]]. A ce rythme, la température pourrait s’élever en un siècle de 5°C, variation qui correspondrait à l’évolution des températures observée depuis la dernière glaciation, c’est-à-dire non pas depuis un siècle mais depuis 20 millénaires. Les conséquences du réchauffement climatique s’annoncent majeures : réduction des terres émergées suite à l’élévation du niveau de la mer, étalement des zones touchées par des crises sanitaires, multiplication des phénomènes extrêmes comme le cyclone sur la Nouvelle-Orléans pendant l’été 2005 ou les canicules des étés 2003 et 2005… Sir Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque Mondiale, évalue le coût du réchauffement climatique à 1% du PIB mondial jusqu’en 2050, puis jusqu’à 38% du PIB mondial d’ici 2200 [[Stern N, Stern Review on the economics of climate change, autumn 2006]]. La réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessite impérativement une révision des modes de production et de consommation d’énergie. Cette transition pourrait être encouragée par les tensions prévisibles sur les prix des énergies fossiles.Le pétrole : jusqu’à quand ?
La formation du pétrole, du gaz, du charbon nécessitant plusieurs milliers d’années, ces combustibles ne sont donc présents qu’en quantité limitée. Les réserves en énergie fossiles pourraient être épuisées à court voire à moyen terme. Le pic pétrolier, c’est-à-dire le moment à partir duquel la moitié du pétrole disponible aura été forée et où la production mondiale de pétrole décroîtra, est annoncé à relativement court terme. Christophe de Margerie, le directeur général de Total, a lui-même annoncé en juin 2008 que de l’avis de sa compagnie, la production pétrolière plafonnerait à partir de 2020 à 100 millions de barils par jour puis déclinerait [[Duval G, Va-t-on réussir à s’en passer?, Alternatives Economiques, n°271, juillet 2008]]. Parallèlement, la demande énergétique mondiale augmente, notamment avec l’essor économique de la Chine et de l’Inde. Le rapport World Energy Outlook 2008 publié par l’Agence Internationale de l’Energie prévoit que la demande en énergie primaire augmentera en moyenne de 1,6% par an d’ici à 2030. La tension entre l’offre et la demande se répercutera très probablement sur les prix, comme la hausse du pétrole jusqu’à 150 dollars le baril en juillet dernier le laisse présager. Et de la même façon que la perte de seulement 10% d’eau d’un corps humain en contenant 70% est fatale, un décalage de 10 à 15% entre l’offre et la demande de pétrole pourrait suffire à déstabiliser totalement notre économie basée sur le pétrole [[Sommes-nous à cours de pétrole ? 03/01/2007, Pierre et Pétrole ]]. La recherche de sources alternatives d’énergie s’impose donc d’autant plus.Quelles alternatives au pétrole ?
Les produits pétroliers à usage énergétique sont utilisés pour les deux tiers dans le secteur des transports, secteur responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre [[DGEMP-DIDEME, L’évolution de la demande énergétique en France dans les secteurs industriel, résidentiel, et des transports, document téléchargeable sur le site de la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières, Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable ]]. Les alternatives aux carburants pétroliers devront répondre à des critères de compaction, de stockage et de transportabilité. Plusieurs pistes font l’objet de développement. Les agrocarburants, par exemple, peuvent se substituer à une partie des carburants pétroliers. Ils soulèvent cependant le problème majeur de la concurrence des cultures énergétiques et alimentaires, et sont accusés d’aggraver les crises alimentaires dans les pays du Sud. Leur bilan environnemental n’est de plus intéressant que dans des conditions données de production, qui ne sont pas toujours compatibles avec la recherche de faibles coûts de productions. Les carburants de deuxième voire de troisième génération (à base de résidus de culture, de cultures non alimentaires, de coproduits des industries alimentaires, d’algues…) pourraient proposer à terme des alternatives pertinentes au pétrole. L’électricité constitue également une alternative aux carburants pétroliers. Des voitures électriques sont d’ores et déjà sur le marché mais ne disposent que d’une faible autonomie. L’autonomie de ces voitures est cependant en passe d’être nettement améliorée grâce au développement des batteries Lithium-Ion. Par ailleurs, des prototypes de voitures munies de panneaux solaires (ces derniers assurant la production d’électricité) apparaissent mais ne circulent pas encore de nuit. Enfin, la pile à combustible constitue une technologie particulièrement prometteuse. Cette dernière est basée sur la combustion de dihydrogène et de dioxygène, qui génère uniquement de l’eau, de la chaleur et de l’électricité. L’obtention d’électricité avec la pile à combustible ne génère donc pas directement de CO2 et autres polluants locaux. L’impact environnemental n’est cependant pas nul. En effet l’hydrogène n’existe pas à l’état natif sur Terre : il est naturellement toujours lié à d’autres atomes, par exemple dans de l’eau ou du méthane. Les réactions chimiques permettant d’isoler du dihydrogène, classiquement à partir d’eau ou de gaz naturel, nécessitent de l’énergie, le plus souvent d’origine fossile. L’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique n’est pas encore intéressante d’un point de vue économique et environnemental (sauf dans des cas particuliers, comme celui de la récupération d’énergie des sources chaudes en Islande). Cette technologie est cependant très prometteuse. L’Union Européenne a d’ailleurs lancé avec des industriels en février dernier Initiative technologie Conjointe (ITC) autour de la pile à combustible et des technologies hydrogène. Un milliard d’euros sur 6 ans sera ainsi mobilisé pour permettre leur commercialisation entre 2010 et 2020. La Commission européenne estime en effet que l’hydrogène pourrait réduire de 40% la consommation pétrolière dans les transports d’ici 2050 [[ Site géré par la Direction Générale de l’Environnement de la Commission Européenne]].Des innovations stratégiques
Les innovations en matière de sources ou vecteurs d’énergie ne nécessitant plus le recours à des produits pétroliers s’annonce stratégique. Il répond à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’inscrit dans la recherche d’indépendance énergétique. Les solutions développées seront probablement plurielles, adaptées aux spécificités de leurs différentes utilisations finales. Parmi ces alternatives, les carburants de nouvelles générations et la pile à combustible semblent particulièrement prometteuses. Les innovations en matière d’agrocarburants sont tout soutenues à l’échelle nationale dans le cadre des pôles de compétitivité. Le pôle de agricole et industrielle en Midi-Pyrénnées ou encore le pôle Industries et Agro-Ressources dans les régions Champagne-Ardenne et Picardie en constituent des illustrations. Les industriels de tous bords investissent eux aussi dans ses technologies prometteuses. Des premières productions d’agrocarburant de deuxième génération pourraient commencer rapidement. Par exemple dans la Marne, le projet Futurol,initié en septembre 2008 pour une durée de huit an, vise à la production de carburant à base de coproduits agricoles, de résidus forestiers [[ Dossier de presse de Futurol]]… Les carburants à base d’algue semblent également prometteur. Boeing, General Electric et Virgin Fuels travaillent ainsi sur un carburant à base de kérosène et d’algues, qui pourrait être utilisé dans le cadre de l’aviation commerciale. En ce qui concerne la pile à combustible, les constructeurs automobiles (Renault, Nissan, Ford, Daimler…) proposent d’ores et déjà des prototypes [[Association Française pour l’Hydrogène AFH2, Memento de l’hydrogène, avril 2008 ]]. Dans le secteur de l’aviation, Boieng a déjà cette année avoir fait voler un aeronef avec une pile à combustible [[Boeing fait voler un aéronef avec des piles à combustible à l’hydrogène, Tourmag, 3 avril 2008, article ]]. Les piles à combustible peuvent également être utilisée pour des appareils électroniques portables. STMIcroelectronics, BIC et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) ont l’objectif d’ici deux ans de commercialiser une pile à combustible permettant de rechercher des téléphones portables (l’alimentation de la pile est prévue au moyen de cartouches d’hydrogènes liquides) [[Une micro pile à combustible pour recharger les téléphones portables sur le marché en 2010., 21/05/08, LesEchos.fr ]]. Uniross, une entreprise française leader européen des piles et batteries rechargeables, est le partenaire de ce consortium. Cependant, dans un contexte de crise financière, Uniross rencontre des difficultés pour combler ses besoins en trésorerie et risque actuellement la liquidation judiciaire [[Seznec Erwan, Accus rechargeables, le leader en panne, brève du 01/12/2008, Que Choisir en ligne, article ]]. La disparition de cet acteur clé du secteur des énergies vertes serait inquiétante, voire paradoxale alors même que la conférence internationale sur le climat vient de se réunir Poznan (Pologne) pour définir un accord pour tenter d’enrayer le changement climatique. Espérons que le Fonds Stratégique d’Investissement français récemment mis en place par le Gouvernement pourra venir en aide à cette entreprise et préserver son savoir faire stratégique aussi bien en termes d’indépendance énergétique que de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
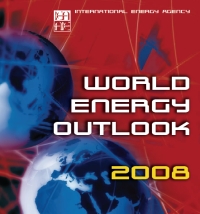


Le tout-pétrole : et après ?
Merci pour cet article très intéressant !
Envie d’en savoir plus, d’aller plus loin sur le sujet : découvrez le livre Pétrole, la fête est finie ! de Richard Heinberg, qui vient de paraître, chez un petit éditeur, Demi-Lune.
Plus d’info à cette page de présentation:
Pétrole : la fête est finie !
Le lien ver la page sur le livre « Pétrole : la fête est finie ! » de Richard HEINBERG aux Editions Demi Lune