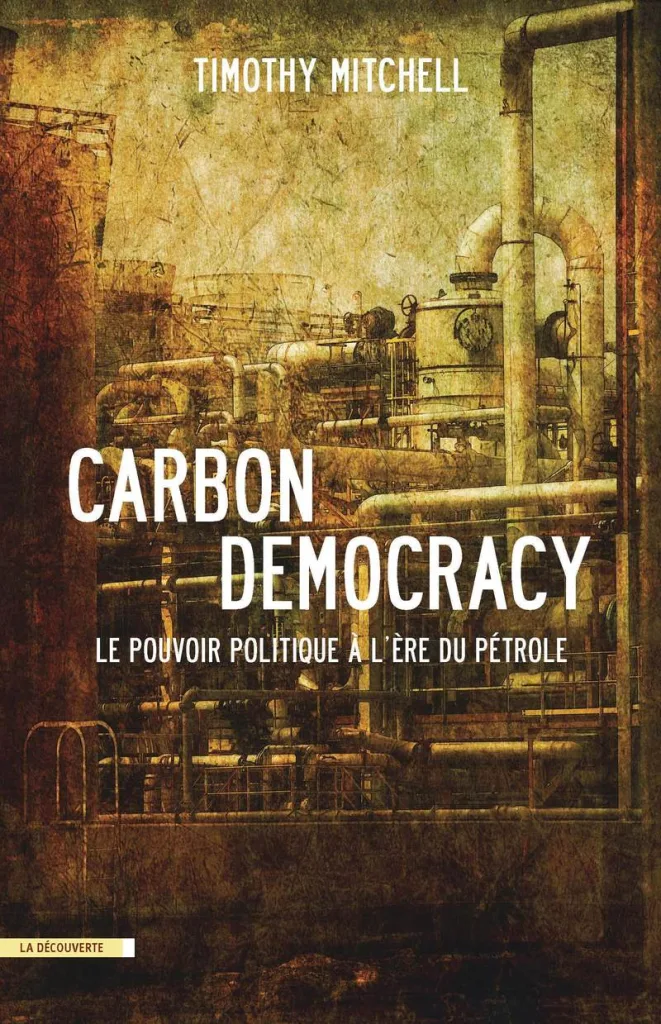À l’heure où l’écologie oscille entre discours alarmistes et injonctions morales, peut-elle encore susciter l’adhésion plutôt que la lassitude ? Les éditions Desclée de Brouwer publient « Comment rendre l’écologie désirable ? » d’Olric de Gélis et de Jean-Marc Jancovici, dans la collection Les Débats du Collège des Bernardins. Issu d’une confrontation intellectuelle exigeante entre un théologien et un ingénieur spécialiste du climat, l’ouvrage explore un désaccord central. La transition écologique doit-elle s’imposer par la contrainte des limites physiques ou s’enraciner dans une transformation culturelle et spirituelle de notre rapport au monde ?

Les chiffres sont sans appel. Selon un baromètre de l’Ademe publié à l’automne 2024, seuls 9 % des Français placent aujourd’hui l’environnement en tête de leurs préoccupations. Plus inquiétant encore, le climato-scepticisme progresse : 38 % des Français s’en réclament désormais, contre 25 % cinq ans plus tôt. Comment expliquer ce décrochage, alors même que les alertes scientifiques se multiplient et que les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles ?
C’est à cette question que tente de répondre « Comment rendre désirable l’écologie ?« , fruit d’un échange organisé au Collège des Bernardins entre Jean-Marc Jancovici, expert énergie-climat bien connu du grand public, et Olric de Gélis, prêtre, docteur en théologie et directeur du pôle de recherche du département Humanités environnementales des Bernardins.
Olric de Gélis défend une conviction singulière. L’écologie ne pourra s’imposer durablement que si elle devient désirable. Nous l’avons interrogé sur ce point de bascule, entre contrainte et promesse, sobriété et joie.
Entretien avec Olric de Gelis

Cdurable.info : Pouvez-vous nous dire ce qu’est le Collège des Bernardins, puisque c’est dans ce lieu que s’est déroulé votre débat avec Jean-Marc Jancovici ?
Olric de Gélis : Le Collège des Bernardins, très factuellement, c’est d’abord un ancien bâtiment monastique. Il a été construit par les cisterciens au XIIIe siècle. Comme beaucoup de bâtiments religieux, il a été repris par la République au moment de la Révolution française, puis il a connu différents usages au fil des siècles.
Il a servi d’entrepôt, de lieu de stockage, je crois même de dépôt de munitions à une époque. Il a été école et surtout, c’est ainsi que les habitants du quartier le connaissaient encore récemment, une caserne de pompiers. Au début des années 2000, il a été racheté par le diocèse de Paris. Il y a eu une très grande phase de rénovation, parce que le bâtiment avait évidemment subi les transformations liées à tous ces usages successifs.
L’objectif de l’archevêque de Paris de l’époque, le cardinal Lustiger, était double. D’abord en faire un lieu de formation en théologie, notamment pour les futurs prêtres. Mais surtout, et c’est très important pour nous, en faire un lieu de dialogue avec le monde. Le cardinal Lustiger pensait qu’on ne pouvait vivre sa foi chrétienne de manière sereine qu’en la confrontant aux questions du monde, aux convictions diverses, y compris religieuses. Lui-même était d’origine juive. Il a donc beaucoup développé le dialogue judéo-chrétien. Nous avons même une yeshiva ici. Juifs et chrétiens travaillent ensemble selon le modèle d’une école talmudique. Le pôle de recherche dont je suis le directeur a pour mission, en particulier, d’orchestrer la question du dialogue avec le monde à partir des grandes questions du moment, dont la question écologique.
En quoi ce cadre particulier permet-il d’aborder l’écologie autrement que dans les arènes politiques ou médiatiques ?
C’est une très bonne question. Nous ne prétendons pas faire mieux que les autres. Nous ne disons pas : « regardez, nous avons la solution ». Ce n’est pas ça. Le pôle de recherche compte 25 projets : écologie, intelligence artificielle, éthique de la santé, sens du travail, géopolitique, y compris des travaux sur le conflit russo-ukrainien ou Israël-Gaza. Ce sont des sujets complexes.
Notre conviction est que ces questions sont trop profondes pour être laissées uniquement aux décideurs, aux spécialistes ou aux militants. Nous voulons rassembler ces acteurs autour de programmes de recherche longs.
Tous ces projets partent de la conviction que ces sujets sont trop complexes pour être laissés soit à la discrétion des décideurs, quels qu’ils soient, soit à la discrétion des spécialistes, par exemple les paléoclimatologues pour la question écologique, soit à la discrétion des militants.
Nous, ce qu’on voudrait, c’est rassembler tous ces gens-là, avec une très forte connotation académique et de recherche, autour de programmes longs de réflexion, en disant que ces questions sont complexes et profondes, et qu’il faut qu’ensemble on apprenne à les creuser.
Ma mission, en tant que directeur du pôle, c’est de veiller à ce que chacun des 25 projets ait son équipe de recherche, entre 10 et 40 personnes, et dans chacune de ces équipes, on place un ou deux théologiens. C’est là notre spécificité. Nous avons des corpus de textes bibliques et théologiques que nous voulons partager avec des chercheurs de tous horizons.
On ne raisonne pas par argument d’autorité. On fait des propositions, on se prête au débat contradictoire. J’accepte que des chercheurs ne partagent pas ma foi ou ne soient pas d’accord avec moi. Mais j’ai l’espérance qu’en travaillant bien les sujets, il y a quelque chose qui peut aider. Le pôle existe depuis 2008. On va bientôt fêter ses 20 ans. Il y a plus de 270 chercheurs, 25 projets. Cela reste modeste à Paris, mais ça attire du monde. On est un peu en dehors des cadres contraints de l’université, avec une très grande liberté académique.

« Je pense que la vraie question, c’est la question du bonheur »
Venons-en à l’écologie. Le vrai problème n’est-il pas existentiel plus qu’écologique ? Avons-nous oublié de nous demander ce qui nous rend heureux ?
C’est une question qui résonne très fort pour moi. D’ailleurs, c’est ce qu’on finit par se dire, en fait, dans ce débat et dans le livre. C’est-à-dire qu’au fond la vraie question, c’est : qu’est-ce que l’on veut ? Que voulons-nous faire ? Je propose une distinction entre une pensée de type normative et une pensée de type générative.
Ce que je veux dire par là, c’est qu’une pensée normative, c’est la pensée de la contrainte. Et je crois qu’effectivement l’écologie souffre énormément de cette pensée de la contrainte. Attention, ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas nécessaire. Mais c’est un registre de pensée.
Il y a un autre registre de pensée, ou un autre registre de propositions, qui sont des propositions génératives, c’est-à-dire des propositions qui vont toucher aux motivations profondes des gens. Qu’est-ce qu’on veut ? Comment est-ce qu’on se motive ? Comment est-ce qu’on embarque les gens sur un projet ? Et ça, je crois que c’est quelque chose qui doit impérativement être fait.
C’est beaucoup plus difficile, dans une période d’urgence, de proposer un langage génératif. C’est beaucoup plus simple, dans une période d’urgence, de recourir au normatif. A force de dire attention, il ya urgence, des catastrophes, on finit par produire une démobilisation des gens. Et le seul recours que l’on a, en fait, c’est le normatif.
Je pense que la vraie question, c’est la question du bonheur. C’est une question qui est tout à fait éclipsée, qui n’est plus traitée aujourd’hui en politique ou même en éthique. Mais la vraie question, c’est cette question du bonheur. Qu’est-ce qu’on veut au fond ? On veut quoi ? Et cette question, il faut qu’on y réponde de manière individuelle et collective. C’est la difficulté.

« L’écologie est une affaire de relation »
Comment alors sortir d’une écologie perçue comme punitive ?
Ce que j’essaie de défendre dans le livre, c’est que l’écologie est une affaire de relation. Je suis assez frappé quand je réfléchis. C’est quoi la cause profonde de la crise écologique ? Je pense que c’est l’individualisme. Un individualisme qui est proposé comme mode de vie, comme vision du monde.
Vous pouvez l’analyser au niveau des individus avec la surconsommation ou l’accumulation. Vous pouvez l’analyser au niveau des collectifs avec des entreprises qui accumulent et qui ont du mal à partager. Au niveau des nations avec des logiques de prédation sur des territoires annexes ou sur des ressources naturelles qui ne sont pas justes.
Tout ça, c’est la pensée du « moi d’abord ». Et cette dureté de cœur à l’égard de son prochain, ou à l’égard d’autres collectifs ou d’autres nations, se retourne immanquablement contre la nature. Pour moi, le point est là. Un des moyens de revenir à la question écologique, c’est de travailler la sagesse des relations.
Vous parlez de cosmologie. Que signifie ce mot ?
La cosmologie, c’est une manière de nous représenter le monde et la vie, et de leur donner du sens.
Ce type de réflexion doit impérativement trouver sa place dans le débat écologique. Parce qu’il est impossible de passer directement d’un discours scientifique ou technique à des applications politiques sans retomber dans une écologie punitive. La cosmologie, c’est une manière de dire : quel monde je veux ? Comment je me représente le monde ? Quel sens je lui donne ? À quoi est-ce que je tiens ? L’individualisme est une cosmologie. C’est une manière de me représenter le monde comme si j’étais seul.
C’est ce que le pape François appelle dans dans son encyclique Laudato si’ la « culture du déchet ». Je prends quelque chose ou quelqu’un, je l’utilise comme ressource, puis je le jette. Je transforme toutes les réalités du monde en objets dont je peux me saisir.
À l’inverse, la culture de la relation dit : ce que j’ai en face de moi n’est pas seulement un objet. C’est autre chose. Les sciences du système Terre montrent très bien un monde où toutes les réalités sont reliées les unes aux autres. Elles sont toutes en interaction les unes avec les autres. Et ça, c’est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que les êtres n’existent pas de manière monadique, comme s’ils étaient seuls. En réalité, ce qui les fait exister, ce qui les fait survivre, ce qui les fait vivre, c’est le lien, ce sont les relations.

« Il est temps de rêver »
Vous insistez d’ailleurs beaucoup dans le livre sur cette relation au collectif, au faire ensemble.
Oui, tout à fait. Je ne crois pas que ce soit naïf de penser cela. Je pense que c’est utopique, peut-être à certains endroits, ça c’est sûr. Mais l’utopie est là aussi pour nous aider à projeter un imaginaire politique. Pour moi, l’utopie a une très grande valeur.
Ce que je ne dis pas dans le livre, mais qui est important pour moi : le pape François dans une encyclique qui s’appelle Fratelli Tutti, dont je m’inspire pour dire tout ça, commence en disant : « Il est temps de rêver. » Et je pense que oui. Je ne dirais pas simplement le rêve, mais l’utopie comme lieu de créativité politique est, à mon avis, cruciale.
« On ne pourra pas traiter la question écologique sans le politique, pas la politique partisane, mais l’organisation collective »
Vous parlez d’une responsabilité devenue planétaire. Mais comment peut-on avoir cette dimension alors que nous sommes dans une société d’individualisme ?
Oui, elle est planétaire parce que les liens sont planétaires. Mon mode de vie aujourd’hui est en train de détruire le mode de vie des gens de l’île de Tuvalu, par exemple, dans le Pacifique Sud, en faisant monter les eaux. C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’on se trouve confronté à une responsabilité à cette échelle.
Après, la grande question, c’est : comment est-ce qu’on fait ? C’est peut-être la seule fois dans l’histoire de l’espèce Homo sapiens qu’on se trouve confronté à cette question. Donc il existe peu de cas du passé sur lesquels on peut s’appuyer.
En revanche, on a quand même une chance absolument incroyable aux XXe et XXIe siècles c’est de disposer d’institutions internationales. Même si ça ne fonctionne pas très bien encore.
Je crois beaucoup en la valeur des institutions. Et là, c’est une connotation politique, au sens du politique, pas de la politique. On ne peut pas traiter la question écologique sans le politique. Je dis bien le politique : l’organisation de la cité, des cités, l’organisation des nations. Des organismes internationaux, qu’ils soient fondés par la communauté des nations, par des ONG… peu importe. Mais il faut des relations internationales normées. Il faut aussi un droit international. Des manières de régler les conflits juridiquement entre les nations.
Je me suis senti corroboré dans ces intuitions par un philosophe, Patrice Maniglier. Il a développé l’idée d’une cosmopolitique à l’heure de la crise écologique, qu’il appelle même une Gaïa politique. Il joue sur les mots entre cosmos, géopolitique et Gaïa politique. Il avance un concept qui me parle beaucoup : l’empiètement des territoires. Les territoires empiètent les uns sur les autres. C’est ce que j’appelle l’extension planétaire de la responsabilité. Maniglier dit très bien qu’on a besoin d’institutions internationales, qu’il faut sans doute les réformer, les adapter à la question climatique, mais qu’on ne pourra pas traiter cette question sans elles.
Vous expliquez dans ce livre que notre conception moderne de la liberté est profondément liée aux énergies fossiles. Est-ce que ça veut dire qu’il va falloir renoncer à certaines libertés ou en inventer d’autres ?
Oui, alors notre type de liberté, en Europe occidentale, est quand même le lieu où philosophiquement on a pensé la liberté, avec notamment la philosophie des Lumières. Cette philosophie des Lumières est devenue un programme politique, elle a acquis une force politique et une force démocratique très forte grâce aux énergies fossiles.
Le charbon qui permet à des corps sociaux de défendre leurs propres intérêts de classe à l’égard des puissants. Le charbon sans les ouvriers, ça n’existe pas. Il faut des ouvriers pour extraire le charbon. Voilà donc ça c’est un point. C’est le XIXe siècle, ça donne la démocratie populaire, la démocratie de masse.
Et puis au XXe siècle, l’arrivée du pétrole va plutôt produire produire plutôt un type de démocratie individuelle. Pourquoi ? Parce que le pétrole précisément permet l’émergence de l’individu. On invente la voiture individuelle avec du pétrole, pas avec du charbon. On invente le packaging individuel avec du pétrole, pas du charbon.
Donc oui, on voit bien — alors ça je ne suis pas le seul à le dire — celui qui l’a vraiment pensé, posé en historien, c’est Timothy Mitchell dans un livre qui s’appelle Carbon Democracy et qui déploie cette thèse dans beaucoup d’autres ramifications. Et vous avez aussi un autre philosophe qui l’a un peu réfléchi, c’est Pierre Charbonnier. Maintenant la grande question qui se pose, c’est si on tient pour acquise cette analyse, et moi je la trouve pertinente, qu’est-ce qui se passe pour la suite ?
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il va falloir, j’en suis absolument convaincu, inventer un autre type de liberté que simplement une liberté axée sur l’autonomie individuelle ou ce qu’on appelait autrefois l’émancipation. Je ne dis pas que ce n’est pas bien, attention, mais le projet émancipateur des individus ne suffit plus, parce que sinon ça produit cette cosmologie individualiste dont j’ai parlé.
Il faut retrouver une liberté qui est, j’ai envie de dire, une liberté de l’attachement. Mais c’est un projet qui est à l’inverse de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c’est : on enlève tous les attachements justement. Donc il faut retrouver une philosophie des attachements.
Et puis il y a un deuxième point. Imaginez qu’on remplace les énergies fossiles par du tout électrique, ça va produire aussi un autre type de liberté. Imaginez par exemple qu’on trouve une surabondance d’énergie électrique parce qu’on a des éoliennes qui tournent tout le temps, du photovoltaïque qui tourne tout le temps et on a résolu le problème du stockage. Ça fait beaucoup de « si », mais imaginons.
En fait vous avez une abondance d’énergie, vous n’avez plus aucune limite. Et ça, c’est quelque chose auquel on doit réfléchir. Les énergies fossiles, elles tuent la planète, on est d’accord, mais elles ont quand même un avantage, c’est qu’elles nous relient à la planète justement. C’est-à-dire qu’une énergie électrique, ça peut être une énergie tout à fait abstraite dans laquelle on n’a plus aucun lien avec la terre.
Ce que dit quelqu’un comme Aurélien Barraud, avec une citation que m’a rapportée un de mes chercheurs, c’est : Vous prenez un bulldozer, vous le mettez avec des panneaux photovoltaïques et après vous pouvez très bien raser la forêt amazonienne avec.
Donc si on veut réinventer un projet de la liberté, moi je dirais qu’il y a au moins deux choses qu’il faut qu’on apprenne. Le premier es ile lien, ce qui nous attache les uns aux autres et ce qui nous attache à ce à quoi on tient. Et puis il y a un deuxième point, c’est l’intégration des limites.
Et dans la mesure où, si on n’a plus aucun rapport avec la nature, avec les êtres, eh bien il faut qu’on s’apprenne les uns les autres à domestiquer nos limites. C’est un projet de liberté sur lequel il faut vraiment réfléchir. En fait je ne suis pas sûr qu’il existe tel quel.
« C’est pour cela que je parle d’amour des humains, mais aussi d’amour de tout le reste du vivant »
Dans un monde plus sobre, peut-on rester heureux ? Autrement dit, à quoi pourrait ressembler très concrètement cette vie désirable dans un monde plus sobre ?
Même avec des conditions d’existence dégradées, les humains ont encore la capacité d’être heureux.
Alors qu’est-ce qui rend heureux dans ces cas-là ? On peut en faire une liste très basique, mais c’est ce que je dis dans le livre, de manière un peu schématique : se réjouir de la naissance d’un enfant, du mariage d’un ami… de ces choses un peu basiques qui font la beauté de la vie. C’est tout simple mais je pense que c’est véritablement important.
Je pense que le sens profond de l’existence humaine, c’est quelque chose qui a à voir avec l’amour. C’est-à-dire être aimé et aimer. Les deux. Être aimé, on en a besoin, et rendre l’amour qu’on a reçu.
Aimer ce n’est pas forcément accumuler des richesses. Je pense que c’est surtout autour de cette question de l’amour, c’est-à-dire des liens, précisément, que les choses peuvent se nouer.
Pour moi c’est vraiment important. Le bonheur n’est pas quantitatif, il est qualitatif. Et la qualité de l’existence est liée à l’amour que je peux donner et que je peux recevoir. L’amour d’abord à l’égard du frère humain, mais également envers le non-humain. Tout le reste du vivant.
Dans la Bible, il y a ce précepte : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il est question d’amour, et pour moi c’est le cœur de la révélation selon la foi chrétienne, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament. La question centrale est celle de l’amour du prochain.
Mais qui est mon prochain ? Est-ce seulement les hommes et les femmes que je côtoie ? Oui, évidemment, et c’est d’abord vers eux que cet amour doit se tourner. Mais si je veux réellement les aimer, alors je dois aussi prendre soin de la création, du reste du vivant. Pourquoi ? Parce qu’on est plus heureux dans un jardin que dans un dépotoir. Cela fait partie des expériences universelles de l’être humain.
C’est pour cela que je parle d’amour des humains, mais aussi d’amour de tout le reste du vivant.
Malgré cela, on observe aujourd’hui de la lassitude, de l’éco-anxiété, et aussi une forme persistante de climato-scepticisme.
Sur le climato-scepticisme, je crois qu’il faut être clair, scientifiquement, cette position ne tient pas. Nous n’avons jamais atteint un consensus aussi fort que celui des rapports du GIEC. Pour la partie scientifique seule, ce sont des dizaines de milliers d’études réanalysées. Il n’existe pas de consensus comparable sur d’autres sujets contemporains. Donc si une opinion climato-sceptique continue de circuler, ce n’est pas pour des raisons scientifiques.
Le problème n’est pas l’établissement des faits. Le problème est ailleurs. Il tient à la question que nous évoquions : qu’est-ce que nous voulons ? Voulons-nous l’accumulation de richesses et la multiplication de la puissance au détriment de la planète, de nos frères humains et du reste du vivant ? Ou voulons-nous autre chose ?
La question climato-sceptique est d’abord politique, éthique et politique. Le débat ne doit plus se situer uniquement sur le terrain scientifique, la démonstration est faite, mais sur celui des projections de société. Qu’est-ce que tu veux au fond ? Et es-tu prêt à en débattre ?
Cette question ne relève pas seulement des experts. Ils ont évidemment leur rôle, mais elle concerne chaque citoyen, y compris le plus modeste. Il faut parvenir à catalyser ce débat collectif.
« Moins il y a de liens entre les humains, moins il y aura de liens avec le reste du vivant. »
Si quelqu’un vous dit : je sais qu’il faut changer, mais je n’en ai pas l’envie ni l’énergie ?
Je pense qu’il existe plusieurs registres pour raviver le désir.
Le premier est celui de la description. Regarder ce que l’on voit aujourd’hui et ce que l’on ne voit plus. Nous avons tous fait l’expérience de la transformation massive des paysages en quinze ou vingt ans : artificialisation des sols, disparition des bosquets, multiplication des parkings de grandes surfaces — ce qu’on appelle parfois la « France moche ». Apprendre à décrire ces mutations est fondamental. L’un des freins à l’engagement écologique tient au manque d’émotion face à ces transformations. Il y a un vide émotionnel. Retrouver une capacité de description, c’est déjà retrouver une capacité d’être affecté.
Je prends un exemple simple. Depuis combien de temps n’a-t-on pas pu patiner sur les étangs du bois de Boulogne à Paris ? Cela fait des décennies. Cela dit quelque chose. Il faut apprendre à voir ce que ces absences signifient. Dans certains ateliers, nous avons développé des méthodes d’auto-description inspirées notamment de l’esprit de Bruno Latour, qui insistait sur cette attention première aux situations concrètes.
Un deuxième registre est celui de la relation. Si vous apprenez à faire attention aux personnes que vous croisez, vous apprendrez aussi à faire attention aux autres vivants. L’inattention aux humains est souvent corrélée à l’inattention au reste du vivant. L’écologie commence sur le palier : connaissez-vous vos voisins ? Les saluez-vous ? Vous intéressez-vous à leur vie ? Vous inquiétez-vous de leur absence ? Il ne s’agit pas d’être intrusif, mais de réapprendre la relation. Moins il y a de liens entre les humains, moins il y aura de liens avec le reste du vivant.
Dans le livre, je dis que pour honorer l’altérité humaine, il faut aussi passer par des altérités non humaines, et réciproquement. Comprendre l’altérité d’un arbre ou d’un animal éclaire notre compréhension de l’altérité humaine, et inversement.
Quelqu’un qui ne veut pas se lancer dans l’écologie, je lui dirais : commence par la question sociale. Engage-toi dans la relation aux autres. De fil en aiguille, la question écologique reviendra.
Un troisième registre consiste à entrer par un enjeu concret, par exemple l’alimentation. C’est une question qui nous touche directement parce qu’elle concerne notre santé, notre rapport au corps. S’y intéresser, c’est immédiatement toucher aux sols, à l’agriculture, aux pesticides — des dizaines de milliers de tonnes chaque année — aux logiques de marché. Ce n’est pas la faute des agriculteurs, mais celle d’un système. Comprendre cela peut redonner envie d’agir.

« La question est comment articuler le registre scientifique avec celui des valeurs, du sens, du désir ? »
Qu’est-ce qui vous oppose à Jean-Marc Jancovici ?
Concernant Jean-Marc Jancovici, je dirais d’abord que nous avons beaucoup de chance d’avoir quelqu’un capable d’expliquer des réalités complexes avec autant de clarté et de rigueur scientifique. Mais son langage reste un langage scientifique. Or la science connaît le global, le planétaire ; elle connaît peu la contingence des lieux et des individus.
Il est donc presque inévitable qu’un discours purement scientifique débouche sur une écologie de contraintes. Elle est nécessaire, mais elle ne peut pas être le seul registre. La question est comment articuler le registre scientifique avec celui des valeurs, du sens, du désir ?
Dès que l’on entre sur le terrain des valeurs, on se situe politiquement. Et cela complique les choses, notamment lorsqu’on s’adresse à des responsables publics. Je crois que la force de Jean-Marc Jancovici est aussi sa limite : il évite largement ce terrain.
« L’écologie ne doit pas être vécue comme un sacrifice permanent, mais comme une promesse »
Vous évoquez aussi Saint François d’Assise…
Saint François d’Assise, c’est une figure magnifique. Il conjugue une sobriété heureuse et un émerveillement profond devant le vivant. Mais sans tomber dans une forme d’animisme qui effacerait la singularité humaine.
Il existe une singularité de l’homme au sein du vivant, l’anthropocène le rappelle. Cette singularité implique une responsabilité. L’être humain est capable de poser des actes, d’organiser des actions collectives, politiques, internationales. C’est ce que j’appelle sa vocation : apprendre à prendre soin des réalités plus fragiles.
François d’Assise a compris la fraternité des créatures et leur dignité commune, tout en maintenant la responsabilité humaine, la nécessité d’une conversion, d’un cheminement, d’actes concrets d’amour, d’accueil, de renoncement et de générosité.
Au fond, je plaide pour une écologie de la joie et de l’espérance. Si la transition ne comporte aucune joie, elle ne tiendra pas. L’image du sabbat biblique me semble parlante : un temps pour s’arrêter, se réjouir, apprendre à habiter le monde.
L’écologie ne doit pas être vécue comme un sacrifice permanent, mais comme une promesse.