Et si les entreprises redistribuaient une partie de leurs bénéfices pour le bien commun de leur territoire d’ancrage ? C’est ce que propose Eric Delannoy1 dans cette note de la Fondation Jean-Jaurès2, où il démontre que le dividende territorial peut être un outil privilégié de responsabilité territoriale des entreprises.
Agir au niveau local permet non seulement de maximiser son impact, mais aussi de renforcer les coopérations avec les écosystèmes locaux, notamment avec l’économie sociale et solidaire et les collectivités.
Timothée Duverger
Responsable de la Chaire TerrESS à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim
- Président fondateur de Tenzing Conseil ↩︎
- Cette note est publiée dans le cadre des travaux menés au sein de l’observatoire de l’expérimentation et de l’innovation locales de la Fondation Jean Jaurès. ↩︎

À l’heure où les urgences sociales et écologiques exigent des réponses concrètes, le dividende territorial incarne une nouvelle forme d’engagement des entreprises. Dans cette note, Éric Delannoy, économiste et président fondateur de Tenzing Conseil, propose de réinvestir localement une part des bénéfices des entreprises, afin que celles-ci contribuent à la cohésion des territoires et à la préservation du bien commun.
Les adaptations auxquelles nous obligent collectivement le dérèglement climatique et les fractures sociales requièrent une mobilisation de moyens de plus en plus importants que l’État seul, surendetté, ne peut assumer. Alors que les territoires ne sont pas exposés aux mêmes risques et n’ont pas accès aux mêmes opportunités, nous sommes de plus en plus contraints de trouver la meilleure manière de mobiliser la puissance économique des entreprises au plus près des besoins de chaque territoire et de créer des coopérations fécondes avec les écosystèmes locaux. La mise en place par chaque entreprise rentable d’un dividende territorial permettrait de remplir cette ambition.
Pour la deuxième année consécutive, le Crédit mutuel Alliance fédérale et la Maif ont annoncé la mise en place d’un dividende sociétal afin de financer des projets d’intérêt général : 15% des bénéfices pour l’un, 10% des bénéfices pour un dividende écologique pour l’autre. En allouant une part des profits à des initiatives de préservation du bien commun, le dividende sociétal correspond à une démarche stratégique de répartition de la valeur créée par l’entreprise. Il prend acte que les parties prenantes silencieuses (l’environnement physique et climatique ainsi que l’environnement social) non seulement contribuent à la performance économique de l’entreprise au même titre que le travail et le capital, mais sont directement affectées par son activité. L’entreprise se doit d’en prendre soin.
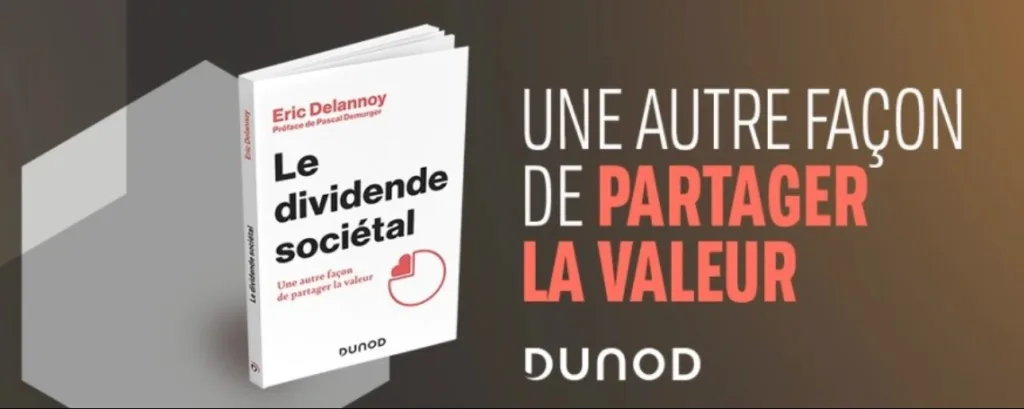
Issu à la fois d’une longue tradition de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (RSE), d’une inscription dans la loi française et de la récente prise de conscience par nos concitoyens que les écosystèmes sociaux, économiques et environnementaux sont interdépendants, ce nouvel outil de gestion est de nature à faire évoluer l’imaginaire capitaliste qui assigne l’entreprise à la seule génération de profit, comme fin en soi. Inscrit au niveau des décisions stratégiques de la gouvernance, le dividende sociétal décentre l’entreprise de son intérêt propre immédiat en faisant de la préoccupation de l’intérêt général une composante clé de l’intérêt privé.
L’enjeu pour la société est de taille. Si chacune des entreprises bénéficiaires – celles-ci représentant les trois quarts des entreprises de manière assez constante dans le temps – consacrait 5% de ses profits dans un dividende sociétal, cela permettrait de mobiliser autour de 10 milliards d’euros chaque année pour mettre en œuvre des projets de lutte contre le dérèglement climatique ou contre les fractures sociales. Soit près de deux fois le budget annuel de France 2030, sans augmentation des impôts.
Comment réussir à le généraliser sans que cela passe par la contrainte ? Trouver les bons leviers de motivation revient à rendre le partage de la valeur désirable, ce qu’il est possible de réaliser par deux voies complémentaires. La première consiste à convaincre les actionnaires qui devront mettre la main à la poche que les bénéfices secondaires demeurent bien supérieurs à ce à quoi ils renoncent, mais sur des temporalités différentes : un renoncement immédiat pour des bénéfices futurs. L’extension de l’incitation fiscale qui existe déjà pour le mécénat dans le cadre de la loi Aillagon de 2003 serait de nature à résoudre cette difficulté. Elle trouve d’ailleurs sa justification économique par les coûts évités pour l’État et par le soutien que le dividende sociétal apporterait au tissu associatif.
La deuxième voie se fonde sur la capacité à faire prendre aux actionnaires la « bonne » décision parce qu’ils se sentent concernés. Herbert Simon, prix Nobel d’économie et précurseur de la science comportementale, a montré que la prise de décision d’un agent économique s’appuie non pas sur une rationalité pure et parfaite mais sur la prise en compte d’éléments de contexte multifactoriels dont les émotions, les biais cognitifs, l’expérience propre et les valeurs de vie. Appliqué aux décisions de gestion, ce théorème implique que le dividende sociétal est d’autant plus facile à décider que le dirigeant et l’actionnaire sont directement confrontés à la fois aux conséquences des différents dysfonctionnements de leur environnement immédiat et aux possibles effets préventifs ou curatifs de leur contribution destinée à les réduire, c’est-à-dire par leur propre confrontation au réel. La notion de proximité, centrale dans la définition même d’un territoire, nous semble donc jouer ici un rôle clé.
Dans cette perspective, le dividende sociétal enclenché dans une perspective territoriale sera qualifié de dividende territorial du fait que sa dimension d’implémentation géographique lui confère une promesse d’efficacité spécifique dans le champs sociétal ou environnemental. En plus de la proximité physique, la notion de territoire porte en soi une proximité humaine d’action et d’intérêts croisés. Un territoire n’existe qu’au travers de ses écosystèmes locaux identifiables par les interactions qui les régissent et les communautés d’intérêts qui lui donnent ses contours et son sens. Ceux qui prennent des décisions sont les mêmes que ceux qui en subissent les conséquences : la proximité est responsabilisante.
Le dividende territorial : outil privilégié de la responsabilité territoriale des entreprises
Le dividende territorial – forme territorialisée du dividende sociétal – répond ainsi à la critique qui lui est faite de ne pas pouvoir produire ses effets au niveau macro-économique du fait de l’émiettement des initiatives micro-économiques : la somme des initiatives totalisant plusieurs milliards de financements n’équivaudrait pas à l’effet systémique d’une politique publique d’un montant du même ordre de grandeur. Nous faisons le pari (qui mériterait d’être mesuré plus précisément) que cet émiettement sur des milliers d’entreprises réparties dans les territoires est compensé par une meilleure pertinence des actions locales et une meilleure efficacité de leur mise en œuvre. Car c’est d’abord à cette échelle que se vivent les effets du dérèglement climatique et les fractures sociales qui y prennent des formes spécifiques, beaucoup plus que dans les grandes métropoles et les lieux de pouvoir où se décident les politiques publiques.
« Les formes de précarité diffèrent selon les régions, la solidarité et l’entraide s’exercent par essence localement, la disparition des espèces se joue différemment selon la géographie, et les instruments de lutte contre le changement climatique varient selon que l’on se trouve à la montagne, en bord de mer, en ville ou à la campagne. L’ancrage territorial et la proximité avec les caractéristiques socioculturelles locales constituent en soi des gages d’efficacité de l’action plus encore que le niveau des montants alloués parce qu’ils permettent un meilleur ciblage des bénéficiaires et une mobilisation des leviers au plus proche de leurs besoins ».
Sans remettre en cause l’utilité des politiques publiques nationales qui seules ont un pouvoir de changement systémique lorsqu’elles sont bien implémentées, l’action à l’échelle nationale doit néanmoins être complétée par des politiques territorialisées, à même de dépasser les intérêts contradictoires des différents lobbies, l’incompatibilité du nécessaire jeu démocratique de la représentation nationale avec l’urgence à agir et le poids du jacobinisme centralisateur éloigné des problématiques de terrain. Quant aux acteurs économiques locaux, ils ne peuvent rester indifférents aux problématiques de leur territoire qui les concernent au premier chef. Dans cette perspective, la responsabilité territoriale des entreprises (RTE) vise à « engager des dynamiques de coopérations ancrées dans des solutions concrètes coconstruites pour le bien commun » pour tenter de pallier l’inertie d’un État surendetté et endogame.
Agir au niveau local : maximiser l’impact macro-économique du dividende sociétal
La RTE mise sur l’action collective de l’ensemble des acteurs du territoire. En intégrant le développement local dans leurs activités, les entreprises cherchent à avoir un impact positif sur la société, à contribuer au bien-être des communautés locales et à promouvoir une croissance économique durable. L’objectif est de contribuer positivement au développement durable des régions dans lesquelles les entreprises opèrent, tout en renforçant leur propre réputation et leur légitimité. Si le bien-fondé de la RTE ne fait plus débat, les questions de ses modalités et de son financement restent entières. Quels moyens les entreprises doivent-elles y consacrer ? À quelle hauteur, selon quel rythme et avec quelles modalités de pilotage ? Le dividende territorial correspond à la modalité de gestion qui répond efficacement à l’ensemble de ces questions.
Alors que le dividende sociétal vise à intégrer la responsabilité vis-à-vis des « parties prenantes silencieuses » au niveau des décisions stratégiques de l’entreprise pour accroître sa résilience à long terme, sa déclinaison territoriale met la RTE au bon niveau décisionnel. Ainsi, le dividende territorial, parce qu’il est élevé au rang de stratégie de répartition de la valeur, échappe en grande partie aux logiques d’actions opportunistes (motivation fréquente du mécénat local) souvent liées aux connivences relationnelles que la relation de proximité a permis de construire. Il se présente comme un outil de pérennisation du rôle politique de l’entreprise sur son territoire en alignant le choix des contributions sur les valeurs et engagements spécifiques de l’entreprise.
Au cœur du rôle politique se situe la logique de coopération. Faire en sorte que l’entreprise soit le plus harmonieusement possible intégrée dans l’environnement dans lequel elle opère suppose une imbrication des intérêts réciproques qui sous-tend la logique de coopération : pour que l’entreprise soit prospère, elle a besoin d’opérer dans un territoire dynamique, aux aménagements modernes et avec des bassins d’emploi aux formations adaptées à ses besoins.
Le dividende territorial comme modalité de coopération entre les entreprises et les écosystèmes locaux
Parce que l’entreprise a une histoire avec son territoire d’implantation, parce qu’elle emploie souvent des familles entières sur plusieurs générations, elles-mêmes imprégnées de la culture locale et des réseaux de solidarité, la proximité géographique se transforme en proximité sociale, les intérêts des dirigeants étant plus congruents avec ceux des salariés que dans les grands centres urbains. Toutes les catégories sociales sont concernées par les mêmes problématiques, même si elles n’ont évidemment pas les mêmes leviers pour y faire face : la distance pour envoyer les enfants à l’université reste la même pour tous, mais tous n’auront pas les mêmes moyens pour la parcourir. Cela arrangera pourtant tout le monde de développer les infrastructures de mobilité. Dans le champ environnemental, les animaux et végétaux vivent dans des écosystèmes locaux et la préservation de la biodiversité verra son efficacité d’autant plus décuplée qu’elle sera adaptée aux problématiques, territoire par territoire : un projet de préservation de lieux d’espèces protégées ne s’appuiera ni sur les mêmes associations ni sur les mêmes entreprises en région Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne-Rhône-Alpes. En somme, les territoires ne sont pas exposés aux mêmes risques et n’ont pas accès aux mêmes opportunités.
Les chaînes de solidarité et les coopérations avec les collectivités territoriales et les acteurs spécialisés seront d’autant plus facilement activées que ceux-ci sont dans les faits tous concernés par les sujets qu’ils traitent. Ainsi, l’action au niveau local est facilitée à la fois par l’existence d’écosystèmes locaux activables, une convergence des intérêts qui réduit les injonctions contradictoires et permet l’émergence de solutions concrètes partagées. Se sentir concerné, meilleur déclencheur d’un changement de politique de répartition de la valeur, prend ici un sens plus concret que jamais, entre personnes qui se connaissent et se reconnaissent.
En somme, la cohésion sociale résulte d’une vision partagée d’une même réalité vécue et des défis à relever et du sentiment que les efforts sont proportionnés aux capacités de chacun. Le dividende territorial traduit la mise à disposition d’une partie de la puissance économique des entreprises locales pour contribuer à l’effort commun, en cohérence avec la place qu’elle souhaite avoir dans le territoire.
Cette tendance est confirmée par les entreprises elles-mêmes : sachant que le mécénat correspond à la forme la plus basique du dividende sociétal, 88% des mécènes privilégient des actions locales ou territoriales. Elle est également plébiscitée par 42% des Français qui estiment que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle indispensable dans le bien commun de leur territoire ou de leur région, loin devant les associations (25%) et juste derrière les collectivités territoriales. Pour autant, les coopérations entre entreprises et collectivités locales sont citées par 43% des Français comme moyen crédible de lutter contre le dérèglement climatique contre 19% pour les entreprises seules. Enfin, 72% des Français se déclarent en faveur du conditionnement des aides à des engagements chiffrés de la part des entreprises. Ce résultat plaiderait en faveur de la mise en place d’incitations fiscales pour celles qui opteront pour un dividende sociétal ou territorial…
Installer des contre-pouvoirs implicites
Résumons-nous : parce que la proximité territoriale crée des convergences d’intérêt et facilite la communauté de vue sur des défis partagés, les dirigeants et les actionnaires d’entreprises territorialisées seront plus enclins à déclencher les moyens pour les relever par la mobilisation d’un dividende territorial. Et parce qu’il met la préoccupation de l’intérêt général au niveau stratégique de l’entreprise, le dividende territorial favorise les coopérations avec les écosystèmes non marchands locaux.
Ce faisant, le dividende territorial rend plus difficile le détournement ou l’appropriation de l’intérêt général au profit de l’intérêt privé, critique qui pouvait être faite au dividende sociétal. La systématisation de l’action collective imbriquant acteurs des sphères publiques, privées, marchandes et non marchandes nécessite de faire vivre en permanence un accord entre tous les acteurs sur les finalités et les moyens pour y parvenir. Cela pose par ailleurs la question légitime d’un pilotage collectif de cette manne privée.
Comment faire accepter à des dirigeants que non seulement une partie de leurs profits va être consacrée à des projets d’intérêt général, mais qu’en plus ils ne garderont pas la maîtrise du pilotage des contributions ? Notons que cette question n’est pas nouvelle, puisque même dans le cadre d’un simple mécénat, de nombreuses entreprises donatrices demandent des garanties de la bonne utilisation de leurs dons à la fois par un fléchage et par une demande souvent excessive d’une mesure d’impact à réaliser par le donataire.
À partir du moment où le dividende territorial présente les mêmes caractéristiques territorialisées que le dividende sociétal, à savoir principalement l’absence de financement d’initiatives ayant un impact direct sur la chaîne de valeur de l’entreprise (du ressort de la RSE) et l’absence de recherche de retour sur investissement (ROI) financier visible qui caractérise sa démarche désintéressée, un pilotage commun centré sur la finalité (quelle solution à quel problème ?) peut être envisagé, car l’intérêt propre de l’entreprise n’est pas mis en danger. Une piste consisterait à définir des structures d’économie mixte opérées pour partie en bénévolat pour piloter la collecte et l’allocation des sommes ou des moyens : fonds de dotations thématiques à parité entre collectivités locales, organismes compétents (associations, ONG, entreprises sociales…) et entreprises engagées, sur une problématique donnée et sur un périmètre géographique donné. Ces structures auraient par ailleurs l’objectif d’accroître leurs moyens en captant les fonds européens dédiés au développement des territoires : le fonds européen de développement régional, le fonds pour une transition juste, ou encore le fonds social européen.
Cette logique collective non seulement met des limites à la captation des bénéfices par les seuls acteurs privés, mais, en miroir, permet également de contourner la décision publique de manière bien plus efficace qu’au niveau national lorsqu’elle est plus clientéliste que pertinente. Cela crée donc des contre-pouvoirs implicites internes que la logique d’action devrait permettre de réguler. Ceci suppose donc d’être capable d’en mesurer l’efficacité, le juge de paix de dernier ressort. La finalité et la mise en œuvre concrète guident l’organisation.
Ainsi, en faisant fonctionner les logiques d’intérêt dans chaque territoire, il devrait être plus facile de convaincre la gouvernance de chaque entreprise rentable de dégager un dividende territorial représentant 5% de ses bénéfices annuels pour les consacrer à la construction de sa résilience future. Il deviendrait alors un levier pour réengager les personnes sur les territoires en donnant les moyens pour faire vivre les solidarités et les savoir-faire locaux loin de l’hubris technocratique. Agir vite et mieux, telle est son ambition en profitant de la puissance économique des entreprises concernées par les défis à relever. Comment alors éviter le risque de repli localiste ? Les grandes sociétés coopératives ou mutualistes l’ont compris depuis toujours : conjuguer centralisation des fonctions régaliennes tout en préservant l’ancrage territorial, à l’instar de la Maif dont les projets éligibles au dividende écologique15 décidé et piloté depuis le siège sont choisis par les sociétaires des territoires pour résoudre des enjeux locaux.


